LE PLURIPARTISME :
GAGE DE LA DEMOCRATIE.
Je sais, mon titre est un truisme. Si, si, convenons en c’est un truisme. Curieusement, j’aime les truismes. Surtout comme celui là. A qui viendrait l’idée de mettre en doute la valeur de truisme de mon allégation ? Personne. Du moins pas vous, hein !
En y repensant, je me demande…
Oui, à la longue, je finis par avoir des doutes.

Bon, essayons de raisonner à l’envers. Disons : le monopartisme (ce que l’on appelle le
parti unique) gage de la dictature. Là, on est sûr. Bah oui, s’il y a parti unique, il n’y a pas d’opposition possible donc, c’est la dictature. La dictature du parti unique. Puisque le parti
unique conduit à la dictature, pour éviter cette dictature, il faut échapper au parti unique. Comme la proposition : le monopartisme entraîne la dictature semble solide, on en conclu que le
contraire est vrai aussi. Oui, mais ce n’est pas une preuve, ça. Il me semble même que c’est un sophisme. Ce n’est pas parce que les chevaux blancs courent vite que les chevaux non blancs ne
courent pas vite. Les scientifiques utilisent une expression bien utile dans le raisonnement. Ils parlent de condition nécessaire et suffisante. Est-il nécessaire pour échapper à une dictature
d’avoir une situation de pluripartisme ? Cela me semble raisonnable. Et même si cela ne l’est pas, nous allons prendre comme hypothèse de travail que ça l’est. En effet, nous avons deux
partis opposés en présence.

Lorsque les gens sont fatigués des agissements de l’un, ils ont tout loisir de voter pour l’autre. L’alternance est assurée ; on est tranquille. Affirmons-le haut et fort, le pluripartisme est une condition nécessaire pour échapper à une dictature, donc pour accéder à la démocratie. Oui, mais est-ce suffisant ? Imaginons deux partis dans une opposition irréductible. Le programme des uns est : pour nourrir le peuple, il faut cultiver plus de salades et les autres clament : la salade est la nourriture du peuple. Vous avez saisi la nuance, j’espère. On voit bien qu’ils sont antinomiques. Je ne sais pas, je dois faire preuve de mauvais esprit ou être intellectuellement limité, mais moi, je trouve cette situation parfaitement totalitaire et sans issue. Dictatoriale, quoi. Moi, je n’aime pas la salade. Je n’aime pas, mais alors pas du tout que l’on me serve des salades.
Reposons les questions. Le pluripartisme est-il nécessaire à la démocratie ? Nous avons dit que nous répondions oui. Est-ce suffisant ? Nous avons vu que non.
Alors, le pluripartisme est-il gage de la démocratie ? Non.
Ah, bah alors… Et notre truisme ?
C’est embêtant, ça.
Pourtant, tout le monde le sait et tout le monde le dit et le répète. Alors, tout le monde le sait le dit et le répète comme un truisme et ce n’est pas vrai ? Alors, tout le monde se trompe. Tout le monde se trompe et personne n’a eu l’idée de le signaler à l’intelligence commune ? Comment une telle déraison a-t-elle pu se glisser dans l’entendement des gens ?
Bon, vous le savez, j’ai très mauvais esprit et, j’aurais bien une petite idée. Je ne sais pas si je vous la dis.
Attendez, je réfléchis. Comment vous expliquer la chose comme je la comprends sans être taxé (éhontément) de dogmatisme éhonté ?
Bon, je vous prends un exemple.

Nous avons un pays qui vit dans une situation de dictature… Celle que vous voulez… Tenez, une dictature financière, par exemple. Vous vous doutez bien que les bénéficiaires de cette situation ne sont pas eux même en première ligne de l’état. Ils ont installé un ou plusieurs personnages clinquants sous les ors de la République et restent tranquillement à l’abri derrière. C’est, du reste, une nécessité parce quand les populations sont excédées, en cas d’émeute, ce n’est pas à eux qu’on s’en prend mais à leurs fantoches, à leur marionnette. Quand l’orage passe, on installe d’autres valets et le tour est joué. Cependant, ce dispositif n’est que modérément satisfaisant. En effet, si les populations voient qu’elles n’ont pas de choix, il leur faut peu de temps pour dénoncer la situation. L’idéal est d’avoir une opposition, une opposition sage, bien policée, une opposition respectueuse de l’ordre établi, une opposition de sa gracieuse majesté. Même, s’il y a plusieurs partis d’opposition, c’est encore mieux. L’extrême liberté de choix n’en est que mieux avérée. Quand l’état est renversé (électoralement), c’est l’autre parti qui prend le relais sans heurt et sans discontinuité. Tout est pour le mieux. Rien n’est changé et les gens ont eu l’illusion d’avoir imposé leur choix démocratiquement. Donc, tout le monde est content et la situation prorogée. Bien sûr, si l’on peut, en plus s’offrir le luxe d’avoir quelques petits partis extrémistes, ceux-ci vont canaliser les mécontents les plus sévères et de ce fait les neutraliser. On utilisera à cet usage des adages comme « les extrêmes se rejoignent », ou bien, « En toutes choses, il faut garder de la modération », ou bien encore « sagesse est mère de sûreté ». Si par malchance, les partis extrémistes risquaient de prendre de l’ampleur, on rappellerait qu’il faut voter utile et les choses rentreraient dans l’ordre.
- Allons, Maître Jean, tu ne vas pas nous chanter le couplet de la grande conspiration, pas toi !
- Moi ? Je ne chante pas.
- Et puis, tu crois que les partis sont créés exprès simultanément pour jouer à ce jeu ?
- Je n’ai pas dit ça.

Revenons au point de départ. Nous sommes dans un pays où l’accession au pouvoir se fait selon un mode électif. Pour chaque poste, il y a plusieurs candidats. Bien sûr, les candidats peuvent ne se réclamer d’aucune attache mais, le plus souvent, pour se soutenir les uns les autres, ils se déclarent proches de tel ou tel tribun connu et ainsi, de fait, se constituent en partis. Pendant longtemps, avec le système de la candidature officielle, les candidats non officiels ont tenu des positions de refus drastique et de propositions novatrices voire révolutionnaires. Puis, les radicaux l’ont été de moins en moins. Les opportunistes sont arrivés qui ont stérilisé pas mal d’espérance. Les socialistes à leur tour sont arrivés et ont abandonné leur image novatrice. Les communistes eux même que depuis leur apparition on présentait comme des boute feu toujours prêts à brandir le drapeau de la révolte se sont auto stérilisés. Dans les deux derniers siècles d’histoire, on a pu constater que tous les partis nés à l’extrême gauche, après un passage de révolte flamboyante on subi un glissement inéluctable vers la droite.
Comment cela se produit-il ?

Je pense qu’il y a essentiellement deux raisons : Une raison d’ordre collectif et une raison d’ordre individuel.
Sur le plan collectif, comme on n’attrape pas les mouches avec du vinaigre, au fil des années, les partis s’auto censurent et se mutilent de leur aspect révolté. C’est qu’il ne faut pas effrayer les foules et ne pas laisser les conservateurs prédire l’apocalypse. Pour des raisons strictement électoralistes, les partis révolutionnaires se vident de leur substance.
Sur le plan individuel, des aventuriers pénètrent les partis d’opposition progressiste pour les
utiliser comme tremplin à leur carrière personnelle. Là, nous observons une situation qui peut être décrite comme une inversion de situation. Ils ne sont pas désignés comme candidats à une
quelconque élection en tant qu’émanation de leur parti ; ils adhèrent à un parti afin que celui-ci leur serve d’infrastructure pour leur candidature personnelle. Vous pensez bien que ces
braves gens n’ont, en arrière pensée, aucune volonté réformatrice. Ils veulent être élus, c’est tout. Qu’ils le soient ou qu’ils ne le soient pas, ils vont occuper des postes clef dans le parti
et de ce fait dénaturer celui ci. Vouloir modifier qualitativement la société, c’est se condamner à, pendant un temps long, ne pas être suivi par la majorité. Donc, si l’on tient à être élu, il
ne faut pas vouloir modifier la société et, le faire bruyamment savoir. Les partis progressiste sont sclérosés de l’intérieur par des éléments pathogènes qui se sont infiltrés insidieusement et
ont proliféré comme une infestation sournoise.

Bien sûr, on ne proclame pas que le parti a retourné sa veste ; non ! Mais avec une fine démagogie on fait prendre aux gens les vessies pour des lanternes.
Il y a eu un homme politique, il y a quelques décennies qui pour un second tour présidentiel appelait à l’abstention en déclarant « c’est blanc bonnet et bonnet blanc ».
Et la démocratie, dans tout ça, qu’est-ce qu’elle devient ?
Cela me rappelle un dessin de la fin du dix huitième siècle. On voyait un cuisinier demander à des volailles : « A quelle sauce voulez-vous être mangés ? » les volailles répondaient : « Mais, nous ne voulons pas être mangés du tout !» Ce à quoi le cuisinier rétorquait : « vous sortez de la question ».
En d’autres termes, on peut en arriver à cette autre conclusion que ce type de démocratie ne peut exister que dans la mesure où il n’envisage pas de changer la forme en place de la démocratie. La démocratie décrite a pour mission de ne pas changer démocratiquement son propre fonctionnement.
Dans tous les sports et jeux, quand, au fil du temps, on s’aperçoit que la règle du jeu est mauvaise, on la modifie. Nous nous trouvons dans une situation où, constatant que le jeu n’est plus possible, au lieu de changer la règle, on se contente de changer d’arbitre.

Alors, le pluripartisme est-il un gage de démocratie ?
Pour verbaliser notre conclusion, je vais la résumer ainsi : Une oligarchie en place intelligente sait promouvoir un pluripartisme donnant une illusion de démocratie laquelle n’est en fait qu’un outil générateur d’immobilisme.
Pendant que nous y sommes, nous avons dit précédemment que nous prenions comme axiome que le pluripartisme, s’il n’était pas suffisant comme gage de la démocratie, en était néanmoins nécessaire.
Ah bon ? Vous y croyez, vous à ça ?
Je sais, c’est un peu plus tordu comme raisonnement et surtout plus difficile à concevoir dans la pratique (voire absurde vu qu’on ne sait pas comment cela serait possible).
Que pensez-vous d’une absence totale de partis ? Les représentants de la population ne se réclamant d’aucun clan seraient obligés de se définir eux même individuellement et ne pourraient plus se réfugier derrière une quelconque discipline de parti. Ne pouvant se fondre dans un flou national (voire international) ils seraient bien obligés de décrire leur programme et leurs intentions. Ils ne pourraient plus répondre de leurs actes et leurs décisions que devant leurs électeurs.
Je sais, c’est un peu irréaliste. Mais je ne suis pas persuadé que la démocratie en pâtirait vraiment.
Nous en arrivons alors à cette constatation bébête que s’il n’y a pas de parti, cela veut dire que tous les individus sont dans le même sac. C’est à dire que tous les représentants élus ou non font partie de ceux qui veulent représenter la population. Le parti de la population. Le parti unique, quoi !
J’en arrive à dire de drôles de choses, moi !
Tenez, avant d’en finir, je voudrais vous rappeler que le Général de Gaulle (Charles 1890 1970) disait quand il a promulgué la constitution de la cinquième république qu’il voulait ainsi en finir avec la politique politicienne et le règne des partis.
Bah, ce n’est pas une grande réussite, hein !
Alors, le pluripartisme gage de la démocratie ? Mais quand arrêterez-vous de croire tout ce qu’on vous raconte ?
Reste une question. Pourquoi nous serine-t-on tant que le pluripartisme est gage de la démocratie ?
Je ne sais pas, moi. Mais je répondrai à cette question par une autre question :
A QUI PROFITE LE CRIME ?

LES PARTIS
Petit tour d’horizon de l’existant.

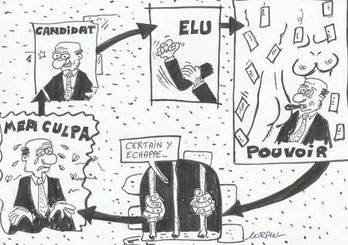
Il y a un moment que je pense à cet article. En fait le précédent ne devait être qu’un paragraphe d’introduction à celui-ci. Et puis, vous me connaissez, je me suis laissé emporter par mon élan.
J’ai l’intention dans cette réflexion de décrire les différents partis politiques existants en France. Je vais donc balayer l’horizon de droite à gauche en tentant d’analyser les différentes factions en y mettant le moins possible de sensibilité personnelle.
I : Le front national.
Pour comprendre le Front National, il faut intégrer la notion de populisme et définir ce mot. A cette fin, j’utilise largement un article tiré de Wikipédia. Le populisme désigne un courant politique, critiquant les élites et prônant le recours au peuple (d’où son nom), s’incarnant dans une figure charismatique (à ce titre, Monsieur Jean Marie Le Pen est remarquable de qualité oratoire et de gouaille faussement populaire) et soutenu par un parti acquis à ce corpus idéologique. Il suppose l'existence d'une démocratie représentative qu’il critique. C'est pourquoi ses manifestations ont réapparu avec l'émergence des démocraties modernes, après avoir connu selon certains historiens une première existence sous la République romaine.
Avant les années 90, les termes « populisme » et « populiste » pouvaient désigner divers courants politiques se référant au peuple, parmi lesquels le parti de centre droit ÖVP autrichien ou le SHP turc au centre-gauche, qu'on a tendance depuis à ne plus vouloir qualifier ainsi, leur préférant le label de « populaire ». Le terme « populisme » a désormais un sens plus restreint, parfois péjoratif, et c'est cette dernière acception que nous utiliserons désormais.
Le populisme est un courant idéologique critiquant l'élite ou des petits groupes d'intérêt particulier de la société. Ces groupes trahiraient les intérêts de la plus grande partie de la population ; les populistes proposent donc de retirer l'appareil d'État des mains de cette élite égoïste, voire criminelle, pour le « mettre au service du peuple ». Monsieur Le Pen stigmatise régulièrement la coalition socialo communiste et plus récemment la collusion droite gauche. Afin de remédier à cette situation, le leader populiste propose des solutions simplistes, souvent appuyées sur des ostracismes ou des exclusions mais ignore complètement les réalités de la décision politique comme la complexité des situations décrites. Ces solutions sont présentées comme applicables tout de suite et émanent d'une opinion publique présentée comme monolithique.

Les populistes critiquent généralement les milieux d'argent ou une minorité quelconque (ethnique, politique, administrative etc.), censée avoir accaparé le pouvoir ; ils leur opposent une majorité postulée, qu'ils courtisent. S'ils accèdent au pouvoir, il peut leur arriver de supprimer les formes traditionnelles de la démocratie, au profit d'institutions autoritaires, présentées comme servant plus authentiquement "le peuple".

Le boulangisme (général Georges Boulanger 1837 1891), le péronisme (Argentine, Juan Domingo Perón,
1896 1974), le poujadisme (Pierre Poujade 1920 2003) sont des mouvements populistes.

Je vous invite à parcourir de courtes biographies de ces personnages. Il est à noter que Monsieur Le
Pen a été député poujadiste. N’oublions pas, de plus que les accessions au pouvoir de Hitler et Mussolini se sont appuyées sur des partis populistes. Enfin, les partis populistes nient leur
appartenance à l’extrême droite et aiment à se donner une image œcuménique. Selon Jean-Marie Le Pen, « l'extrême droite, le mot est équivoque dans la mesure où il comporte le mot extrême. Nos adversaires confondent volontairement, et dans
l'intention de tromper, une position géographique sur l'échiquier politique avec une position d'extrémisme politique.

Or notre philosophie, notre principe d'action et notre programme ne sont pas extrémistes et par conséquent nous occupons la place qui est libre.
Pour résumer : Un parti populiste est un parti qui derrière une phraséologie démagogique faussement populaire cherche à tromper la population pour accéder au pouvoir afin d’y appliquer une politique extrêmement réactionnaire remplaçant des acquis démocratiques par des procédés totalitaires en pratiquant l’exclusion et le sectarisme et en rejetant toute forme d’intelligence et de culture « quand j’entends prononcer le mot culture, je sors mon revolver ».
Vous voyez que quand je dis que le Front national est un parti populiste, je suis assez proche de la réalité. Il me reste juste quelques compléments à apporter.

Le Front national a repris le nom d’une tentative de confédération nationaliste qui en 1934 avait regroupé les mouvements ultra réactionnaires proches du fascisme italien et du nazisme allemand qui se donnait pour mission de lutter contre ce qui allait devenir le « front populaire ».
Le front national affiche un catholicisme militant.
Le front national est souverainiste (il refuse toute collaboration avec l’union européenne).
Les deux caractéristiques précédentes entraînent son sectarisme religieux et sa xénophobie.
Le Front national se nourrit des déceptions des électeurs. C’est parce que Monsieur Jospin avait trop blessé l’attente de la population qu’il a été battu par Monsieur Le Pen.
Le Front national, pour que la population s’assimile mieux à lui, a besoin d’afficher la discrimination dont il est l’objet. En effet, puisque le peuple est spolié, si le Front national l’est aussi, cela prouve bien que le Front national est le parti qui est le plus proche du peuple. Monsieur Le Pen par son charisme remarquable et son ton goguenard et bonhomme aime à rappeler la diabolisation et l’injustice électorale dont son parti est victime. A ce titre, il a du reste raison mais il oublie juste de dire que c’est un système de scrutin qui a, justement, pour mission d’éliminer l’ensemble des petits partis et pas seulement le sien.

Eu égard à certains propos xénophobes, racistes et négationnistes de Monsieur Le Pen, certains voudraient voir dissoudre le Front national. Ce serait, outre un déni de démocratie, une faute tactique et une absurdité. Le Front national se présentant comme le seul à proposer une solution alternative aux difficultés de vivre du peuple de France, cela lui permettrait de confirmer son hypothétique statut de seul véritable opposant au système en place. Cela lui permettrait de franchir la marche entre parti persécuté et parti martyr.
La lutte contre un parti populiste ne peut être qu’idéologique. Toute tentative de répression judiciaire ne peut que le renforcer. Ici ou là, le Front national a pu remporter des victoires dans des élections municipales. Les scandales financiers et les nervis de chocs ont fleuri et les gens ont vite compris que ce n’était pas le paradis.
En même temps, et nous en reparlerons plus tard, les autres partis n’ayant effectivement aucun programme théorique à proposer pour une amélioration sociologique quelconque, ceux-ci n’ont comme arme que de lancer des anathèmes ce qui est parfaitement inefficace voire grotesque.
Le Front national voulant se donner une image populaire de justice, de pureté et de bonheur possible se nourrit des désillusions et de l’amertume. Tant que l’organisation de la société continuera de croupir dans un marasme révoltant, tant que les partis qui se disent progressistes n’auront rien d’autre à proposer en avenir d’espérance, le Front national sous sa forme actuelle ou sous une autre aura de beaux jours devant lui.
II : Le Mouvement pour la France
Ce parti est souvent oublié mais il n’en recouvre pas moins une frange notable de la population. Il s’agit du parti dont le personnage principal est Monsieur Philippe De Villiers.
Ce parti est un parti d’extrême droite souverainiste (anti-européen). On pourrait penser qu’il est de fait très proche du Front national et des tentatives de rapprochement ont été tentées à plusieurs reprises. Il n’en est rien. L’essence du Mouvement pour la France est toute autre.
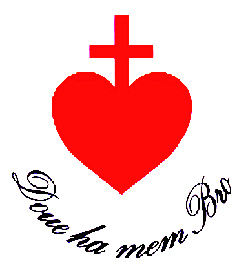
Pour le comprendre, il faut connaître un peu mieux son fondateur. Monsieur De Villiers (de son nom véritable : Philippe Le Jolis de Villiers de Saintignon) est un descendant de l’ancienne aristocratie nobiliaire de l’ancien régime. Sa famille est anoblie par une lettre patente de 1595. Il est d’autre part originaire et natif de Vendée (région connue pour ses activités antirépublicaines lors de la révolution). Monsieur de Villiers est l’instigateur du fameux spectacle son et lumière du Puy du Fou qui, plus ou moins, tente de réhabiliter la très réactionnaire chouannerie chère à son cœur. En fait, Monsieur De Villiers est, rigoureusement, ce qu’on peut appeler un réactionnaire en ce sens qu’il milite pour un retour à une situation du passé. Tout en affichant ostensiblement son attache à l’église catholique, et son soutien à l’enseignement privé, il aurait été brièvement proche de la Nouvelle Action royaliste, branche dissidente de la Restauration nationale. La Restauration nationale, (Centre de propagande royaliste et d'Action française, aujourd'hui RN) est une formation politique royaliste française fondée en 1955 par Pierre Juhel et Louis-Olivier de Roux, originellement issue de l'Action française et de la doctrine du nationalisme intégral de Charles Maurras.
On comprendra ainsi que le mouvement pour la France par sa volonté légitimiste, étant éminemment passéiste, ne peut pas avoir de réel intérêt commun avec le front national qui lui est populiste et démagogue.
Pour des raisons électoralistes, le Mouvement pour la France s’est allié tantôt avec l’UMP, tantôt avec l’UDF voire tantôt avec le FN.
En fait, le Mouvement pour la France de Monsieur Philippe de Villiers, s’il prône bien un changement de système social pour résoudre les difficultés des Français ne cherche pas à aller de l’avant mais verrait d’un bon œil le retour du système féodal.
Disons que c’est un parti réactionnaire traditionnel qui draine quelques nostalgiques de l’ancien régime et de pauvres gens qui croient que le riches ne sont pas des voleurs et que les seigneurs féodaux étaient toujours de braves gens bons pour leurs vassaux et leurs serfs.
III: L’UMP

Dans mon tour d’horizon, c’était, me semblait-il le parti le moins compliqué à concevoir et à comprendre. Et puis, en y réfléchissant, je continue de penser que c’est assez limpide mais tous comptes fait pas si simple que ça. Je m’étais dit : là, je vais pouvoir faire court… Bah je ne suis plus si sûr… On verra.
L’UMP est le parti central et constitutif de la cinquième république. Voyons-en un rapide historique.
1947 - 1953 : Rassemblement du peuple français (RPF) : parti politique fondé par Charles de Gaulle à la Libération pour mettre en œuvre son programme politique exposé dans le discours de Bayeux.
1956 - 1958 : Républicains sociaux.
En 1958 Le Général de Gaulle fonde l’UNR (union pour la nouvelle république).
En 1962, l'UNR se regroupe avec l'Union démocratique du travail (UDT) pour constituer l’UNR-UDT.
En 1967, ses candidats se présentent sous l'étiquette « Union démocratique pour la Ve République » (UD-Ve République). 200 sur 486 députés sont élus sous cette dénomination.

Il lui fallut l'appoint de 42 Républicains-Indépendants et de quelques non-inscrits pour être majoritaire.
En 1968, elle prend le nom d'UDR (Union pour la défense de la République) qui se modifie après les élections en Union des démocrates pour la République. Elle fait alors élire 293 députés sur 487, soit la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale à elle seule.
Le 5 décembre 1976, création du RPR par Jacques Chirac. Le Rassemblement pour la République (RPR)
était un parti politique français de droite, se revendiquant du gaullisme, à savoir d’une politique inspirée par Charles de Gaulle et la Résistance durant la Seconde Guerre
mondiale.

Il a été créé sous l’impulsion de Jacques Chirac, alors en conflit personnel (mais non idéologique) avec le président de la République issu des Républicains indépendants, Valéry Giscard d'Estaing. Il était considéré comme l'équivalent français du Parti conservateur britannique. Il a été remplacé par l'UMP lors des élections de 2002. L'Union pour un mouvement populaire (UMP) est un parti politique français de droite, nommé à sa création Union pour la majorité présidentielle, en vue de soutenir la candidature du président Jacques Chirac à sa propre succession en 2002. Il est membre du Parti populaire européen, ainsi que de l'Union démocratique internationale, association des partis de centre-droit à l'échelle mondiale. Regroupant le RPR et Démocratie libérale, l'UMP a été rejoint à sa création par deux tiers des députés de l'Union pour la démocratie française (UDF). Ce parti est donc un rassemblement de forces gaullistes, libérales et du centre-droit. Il tend donc à rassembler les tendances divergentes, libérales et traditionnelles de la droite française.
A travers son histoire et ses différentes appellations, l’UMP a donc toujours cherché à regrouper les différentes fluctuations de la droite traditionnelle et conservatrice. Après chaque dissidence et divisions, elle a toujours voulu réunir les forces éparses afin de reconstituer un parti suffisamment fort et cohérent pour générer une coalition gouvernementale stable.
Selon tout bon sens, on pourrait penser que l’UMP étant l’archétype du parti conservateur (au sens premier du terme c’est à dire qui ne veut en rien modifier la société), on pourrait en conclure que son immobilisme fondamental conduit à ne rien avoir à en dire. Paradoxalement, ce n’est pas vrai. Il ne faut pas confondre conservatisme social et immobilisme administratif. En effet, s’il est entendu que l’UMP (descendant et héritier des candidatures officielles) ne veut surtout rien changer de fondamental à la société mais, simultanément, il déploie des efforts importants pour que la situation soit maintenue. Il va de soi que, pour que le statu quo soit pérennisé, il faut dépenser une énergie importante. L’actuel président de la République, Monsieur Nicolas Sarkozy, est exemplaire dans ce domaine. Persuadé que le système capitaliste est le meilleur moyen de gérer la société, il cherche par tous les moyens à l’humaniser, à le rendre populaire et à le détourner de ses penchants spécifiques. Cela lui demande une débauche d’énergie que, même si l’on est persuadé de son aspect illusoire, n’en est pas moins admirable.

L’UMP étant, comme je l’ai déjà dit la continuation de l’ancien système des candidatures officielles, est un parti de notables. Ses élus sont tous issus des niveaux moyens de la société : Médecins, avocats, patrons de moyennes entreprises et autres. Leur tâche est redoutable. Leur penchant naturel les conduirait à renforcer les dispositions améliorant les intérêts des entreprises (c’est à dire de leurs actionnaires ou propriétaires) mais en même temps, ils doivent gérer les choses en évitant de pousser les citoyens à des situations de crise les conduisant à des mouvements d’émeute. Ils doivent appliquer des consignes internationales ou des souhaits propres tendant à éliminer des travailleurs indépendants ou des patrons de petites entreprises mais en même temps promettre des aides et des réglementations préférentielles aux mêmes individus (Je vous renvoie à ce sujet au rôle économique de l’état traité dans l’article du 9 avril 2008 « l’état deuxième chant »). L’UMP ayant une volonté de gouvernement doit, à toute fin, garder un électorat majoritaire mais en même temps satisfaire aux exigences du système de mondialisation capitaliste libérale dont il est le zélateur.
Il s’ensuit que la terreur de l’UMP se traduit par la hantise d’une opposition qui offrirait un tout autre système socio-politique.
L’UMP est en permanence parcourue par des contradictions internes.
Etant l’émanation et l’outil de l’oligarchie financière dirigeante, elle se doit de garder un appui populaire large.
Etant fondamentalement républicaine, elle est conduite régulièrement à légiférer en utilisant un article de la constitution lui permettant de passer outre aux décisions du législatif de façon autoritaire (voire totalitaire). De plus, elle entretient et tente toujours de majorer la prééminence de l’exécutif sur le législatif. En revanche, lors d’élections nationales, les opposants de « gauche » à l’UMP, n’ayant rien de plus à proposer ne peuvent que lancer des excommunications et pratiquent régulièrement un chantage au Fascisme. Lors des dernières élections présidentielles, on entendait des gens dire « Si Sarko est élu, on va être obligés de quitter la France ». C’est absurde.
Tout en étant zélatrice du libéralisme économique mondial, elle agit dans un esprit de souverainisme économique. A ce titre, historiquement, Le Général de Gaulle, dans un esprit de nationalisme économique, a ouvert la voie en exigeant le retrait des troupes d’occupations américaines du territoire national ce qui impliquait en contre partie de faire sortir la France de l’OTAN (organisation du traité de l’Atlantique nord) alors sous la domination des Etats Unis et leur volonté d’hégémonie mondiale. Son but étant de régénérer une économie capitaliste strictement française il lui fallait s’opposer aux Etats unis d’Amérique. Pour y parvenir, et c’est là qu’est la contradiction, il a été conduit à agir vaillamment dans la création de l’union européenne : contre poids à l’industrie américaine. Il est amusant de constater que lors de la première guerre du golfe, François Mitterrand, socialiste, dans un souci de rapprochement avec les états unis et leurs satellites a engagé la France dans le conflit tandis que Monsieur Jacques Chirac (UMP), lors de la deuxième guerre du golfe a refusé cette même allégeance (préférant se garder de possibles débouchés économiques et des amitiés dans le monde arabe).
L’UMP n’affiche pas d’appartenance religieuse particulière (ce qui nuirait à son besoin chronique d’électorat). En revanche, l’autre grande force conservatrice française qu’est l’église catholique lui apporte tout son soutien.
Reste à définir qui est l’électorat de l’UMP. Tout naturellement, tous les gens qui, en eux même, sont
des conservateurs : Tous ceux que l’aventurisme effraie, tous ceux qui, pensant posséder un petit pécule, ont peur de s’en voir privés. Autrefois, les partis conservateurs du dix-neuvième
siècle agitaient comme un épouvantail le spectre des partageux.

En gros, on peut dire que l’UMP a repris le flambeau. Tous les gens timorés, peu ouverts sur les possibilités autres, par peur du chaos, par frilosité préfèrent demeurer dans un conservatisme bien pensant et doucereux. En fait cela revient à ce que je décrivais dans un précédent article sur la notion de grève. Dans l’UMP, l’esprit « jaune » triomphe au détriment de l’esprit « rouge ». Partant de l’adage qu’on sait ce qu’on perd mais qu’on ne sait pas ce qu’on va avoir, tous les gens qui préfèrent substituer, par ignorance, le respect des habitudes aux novations, se réfugient dans le conservatisme et le statu quo. Attention, je ne dis pas que les électeurs de l’UMP sont bêtes ! Dans l’UMP, comme dans nombre d’autres partis, il y a des gens fort instruits. Non, Je dis que dans l’UMP, il y a des électeurs et des adhérents qui tiennent cette position parce qu’ils y ont socialement et économiquement intérêt, d’autres parce qu’ils pensent y avoir intérêt, d’autre par tradition familiale qu’il est impensable de modifier et d’autres encore par frilosité et refuge devant la peur du changement et de l’aventurisme incontrôlée.
Ce sont les conservateurs.
LES PARTIS
Petit tour d’horizon de l’existant.
IV: Le MoDem.

S’il y a une chose difficile à définir, c’est bien celle là. Si vous aimez le baveux, le flou, l’incertain, le confus, l’ambigu et l’instable et fluctuant, vous allez être servis.
J’allais écrire pour clarifier, commençons par l’historique. Et bien non, justement, c’est là que c’est le pire. L’histoire et la genèse du MoDem est une longue suite d’alliances et de scissions, de volontés contredites par les faits et d’instabilité chronique. Lorsqu’ en 1958 le Général de Gaulle déclare en finir avec la République des partis, c’est justement contre cela qu’il entend s’élever.
Pour essayer de si retrouver, je vais rembobiner le film afin que vous puissiez un peu mieux comprendre.
Pourtant, comme je vous connais, je pense qu’il ne sera pas inutile que vous relisiez la chose plusieurs fois. Non, je ne dis pas que vous êtes bêtes ! Mais j’avoue, ce n’est pas simple. C’est même cela qui incite beaucoup de gens à dire : « J’aime pas la politique !».
Bon, allons ! Haut les cœurs !
Le MoDem dérive de L’UDF (Union pour la démocratie française).
L’UDF est générée par l’union de six composantes ayant elles même leur histoire propre. Je vous en donne la liste et nous parcourrons ensemble l’évolution de chacune d’elles.
- Le centre des démocrates sociaux.
- Le parti social démocrate (PSD).
- La fédération nationale des clubs « perspective et réalité ».
- Le parti républicain.
- Le parti radical (dit valoisien)
- Les adhérents directs de l’UDF non membres d’un de ces partis.
Maintenant, reprenons les un par un.
Le centre des démocrates sociaux (CDS).

Il trouve son origine (en 1976) dans le MRP né en 1944 (Mouvement républicain populaire) : parti démocrate chrétien fidèle à la doctrine sociale de l’église catholique. Ce parti voulait résister au Général de Gaulle et espérait dépasser le clivage : droite gauche. Tiens ! Bah ce n’est pas une nouveauté, ça alors ! Le MRP est lui même la continuation du parti démocrate populaire (PDP) né en 1924. C’est le premier rassemblement d’envergure sur le plan politique et non confessionnel de la démocratie chrétienne. Il représente la tendance avancée du catholicisme social français par ses prises de positions politique et sociale, tout en demeurant un parti incarnant l’idéologie du centrisme.
Un mot sur la démocratie chrétienne. Il n’est pas de moi. Je le prends dans Wikipédia. Il semble que l'expression « démocratie chrétienne » ait été employée pour la première fois le 21 novembre 1791, devant l'Assemblée législative, par Antoine-Adrien Lamourette, évêque constitutionnel de Lyon.
Ce n'est que plus tard, à partir de 1848, que la formule sera popularisée par Frédéric Ozanam et prendra son sens actuel, c'est-à-dire celui d'un gouvernement démocratique cherchant à mettre en oeuvre la doctrine de l'Église.

En effet, à cette époque, l'idée d'un gouvernement cherchant à mettre en oeuvre, dans un cadre démocratique, la doctrine de l'Église, n'est absolument pas évidente. L'Église catholique reste alors attachée à l'idée d'un pouvoir politique d'origine divine, et rejette donc toute forme de pouvoir politique démocratique. Accepter que des mouvements politiques cherchent, dans un cadre démocratique, à mettre en oeuvre la doctrine de l'Église reviendrait à accepter tacitement l'idée de démocratie, et donc à renoncer à cet idéal de légitimation religieuse du pouvoir politique. Jusqu'au début du XXe siècle, l'Église sera partagée entre, d'une part, réaffirmer la légitimation religieuse du pouvoir politique, et de l'autre, admettre que les catholiques puissent participer à la vie de la cité pour y faire prévaloir leurs idées.
Ce débat demeurera très vif tout au long du XIXe siècle, notamment en France, à partir de 1870 : beaucoup de religieux rejettent alors l'idée républicaine et font du rétablissement de la monarchie une question de principe. Je vous renvoie une nouvelle fois à cette notion de l’état qui est la gestion de la cité des hommes (Babylone) en attendant la cité de Dieu (Jérusalem céleste).

Bien ! Après les démocrates sociaux, nous allons passer aux sociaux démocrates. Bah si, regardez plus haut, vous n’aviez pas remarqué ? Vous voyez que vous n’êtes pas très attentifs, hein !
Bon, là, ce n’est pas très compliqué. Les sociaux démocrates, ce sont plusieurs groupes qui après s’être détachés des socialistes qu’ils trouvaient trop à gauche (surtout au moment de l’alliance de ceux-ci avec les communistes) ont glissé à droite et se sont rapprochés du centre.
Les clubs « perspective et réalité ». C’est un groupe un peu disparate qui rejoindra tardivement l’UDF.
Le parti républicain. Il tire son origine des républicains indépendants. Ces républicains indépendants (sous diverses appellations) sont un groupe d’homme nettement marqués à droite sous la troisième et la quatrième République. En 1945, Ils refusent de participer au « parti républicain de la liberté ». Ce dernier tentait de réhabiliter les anciens partis de droite complètement discrédités par leur collaboration à l’occupant et au régime de Vichy. On a brocardé, à l’époque, « cette droite se découvrant subitement un amour pour la république et la liberté » qui, au demeurant, aurait aimé récupérer en son sein, les anciens groupes d’extrême droite comme l’action française (ancêtre de l’actuel front national) ou moins extrémiste et sans doute moins anti-républicains les anciens « croix de feu ». On pourrait donc en conclure que ces républicains indépendants n’étaient pas si droitistes que ça. Erreur. Ce n’était qu’une question de prééminence. En effet, quelques années plus tard, ces mêmes « parti républicains de la liberté » étaient absorbés par les républicains indépendants. Ce parti fut celui de Monsieur Valéry Giscard d’Estaing. C’est même pour la candidature de celui–ci à la présidence de la République que fut fondée l’UDF.
Le parti radical (dit valoisien vu l’adresse de sa raison sociale place de Valois à Paris) pour ne pas le confondre avec le parti radical dit de gauche. Nous reparlerons dans le prochain article de cette singularité. Quoi qu’il en soit, puisque ce parti radical, n’est pas celui de gauche, c’est qu’il est celui de droite.
Pour finir, il reste, évidemment, les gens qui ont adhéré à l’UDF sans jamais avoir appartenu précédemment à l’une ou l’autre des mouvances décrites.
Qu’il soit bien entendu que dans cette description, je schématise à l’extrême au risque de devenir caricatural à seule fin d’économiser votre outil cérébral. Dans la réalité, c’est bien plus complexe que ça et j’ai utilisé des raccourcis farouches. De toutes façons, je vous incite vivement à relire et réviser parce que la semaine prochaine, de façon inopinée et par surprise, je vous dis que je ne vous préviens pas, mais, il y a interrogation !
Quoi qu’il en soit, au fil de ces scissions et de ces regroupements ressemblant à des turpitudes de grenouilles dans une mare glauque et trouble, on peut remarquer quelques constantes.
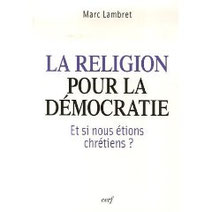
Le MoDem reste un ensemble de clubs de notables ayant besoin d’un parti (même virtuel) pour asseoir leur promotion politique individuelle. Mis à part les radicaux pour lesquels c’est nettement moins vrai, on y constate l’omniprésence de la main mise de l’église catholique. Le MoDem, dans son histoire a toujours cherché à diluer les conquêtes sociales dans un supranationalisme de circonstance. A ce titre, quatre exemples. Dans les années qui ont suivi la première guerre mondiale, il a tenté de perpétuer « l’union sacrée » de la période de guerre ce qui lui permettait de réintégrer la démocratie chrétienne dans le monde politique et en même temps de marginaliser toutes les forces socialistes. Pendant la seconde guerre mondiale il participe au gouvernement de Vichy et de ce fait n’hésite pas à se compromettre avec les forces nazies. Passée cette guerre, il se jette dans l’atlantisme et la vassalisation aux Etats unis. Pour finir, il cherche à éteindre les avancées sociales inhérentes à la France en les interdisant au nom de l’Union Européenne. A ce sujet, le patron historique de l’UDF, Monsieur Valéry Giscard d’Estaing tente de rédiger une pseudo constitution européenne qui ressemble plus à un règlement intérieur d’entreprise qu’à une constitution. Nous y reviendrons dans un article sur l’Europe à venir. C’est un parti qui prône le libéralisme économique. Or, une plus grande liberté légale pour les chefs d’entreprises, cela sous entend des garanties moindres pour les salariés.
La pierre angulaire du MoDem reste la volonté farouche à se faire passer pour un parti centriste.

Réfléchissons un peu sur cette notion de parti centriste. L’idée est d’avoir un grand parti sérieux qui, rejetant les extrémismes de tous bords gère la société comme une vaste entreprise. Tiens, comme c’est curieux, on retrouve cette notion qui aimerait remplacer une constitution par un règlement intérieur. Un parti centriste cherche à rassembler sous son étiquette, au nom du bon sens et de l’équilibre d’une voie moyenne, une majorité d’individus acquis à l’esprit « jaune » (déjà décrit) vers une soumission mesquine de collaboration de classes et un abandon des revendications sociales. C’est un parti qui, cherchant une hégémonie, niant la qualité d’une opposition idéologique, cherche à en éliminer l’existence physique. En définitive, on peut se demander si le MoDem (et ses appellations antérieures) ne cherche pas a instituer un système de parti unique (assis sur la morale de l’église catholique, ne l’oublions pas) en abolissant de fait les possibilités d’autres voies. Il est à noter que les transfuges de droite et de gauche confirment que dans le fond, les divergences théoriques sont bien minces.
Le MoDem, après avoir été vichyste, étant devenu atlantiste et pro américain, ne peut qu’être adversaire farouche de l’UMP, lequel étant, par le biais du Gaullisme du côté de la résistance et nationaliste. Ceci n’empêche pas du reste des alliances locales dans la course aux sièges électifs. Il est à noter que les fuites du MoDem vers l’UMP sont une réalité chronique.
De ce qui précède, on peut se demander si le MoDem qui, de façon opiniâtre, tient à siéger au centre n’est pas, en définitive, plus à droite que l’UMP. On remarquera au passage, que l’UMP, par la personne de l’actuel Président de la République, Monsieur Nicolas Sarkozy, joue à bouffer le jeu du MoDem en affichant, lui aussi et de façon plus efficace parce que déjà en place, l’image de l’œcuménisme.

Il reste à constater que le MoDem, vu son caractère « jaune » est drastiquement opposé à toute doctrine socialiste. Pendant longtemps, son intention permanente a été de tendre la main à « la gauche non socialiste ». On notera deux exemples de cette disposition d’esprit : en 1936 pour lutter contre le « cartel des gauches » (gouvernement issu du « front populaire »), époque à laquelle fleurissait l’expression « plutôt Hitler que le front populaire » et en 1981 lors de l’élection de François Mitterrand. C’est même cela qui a provoqué l’éclatement du parti radical. Ajoutons à cela que lors d’élections diverses, on a vu souvent le MoDem (ou ses formes antérieures) s’allier à l’extrême droite mais jamais à l’extrême gauche.
Pour résumer, on peut dire que le MoDem, ventre mou de la société politique française, est l’aboutissement d’une nébuleuse de partis de droite qui cherche à se donner une image de sagesse centriste afin de se faire élire par des voix de gauche un peu vacillantes.
Quand on est au milieu du conservatisme,
Peut-on prétendre être au milieu
Des aspirations populaires ?
LES PARTIS
Petit tour d’horizon de l’existant.
Les Radicaux.
Certains esprits pertinents seront surpris que je parle d’un parti auquel personne ne fait jamais allusion. Oui ! Pertinent ! Cependant ce parti existe, que voulez-vous que j’y fasse ! Mieux, il existe en double exemplaire. Si, si, si ! Il y en a deux. Un de gauche (qui s’appelle de gauche) et un de droite qui ne veut surtout pas qu’on le nomme ainsi. Comme ce dernier a honte de son ralliement à la droite, il préfère se faire désigner par l’adresse où est située son siège social (place de Valois à Paris d’où : Parti radical valoisien)… De l’art de ne pas assumer ses obédiences.
Essayons donc de décrire ce parti. D’abord, pour le comprendre un peu, il faut définir le mot radical. Radical : 1°) qui vient à la racine (feuille radicale) 2°) (Figuré) Ce qui a rapport au principe d’une chose, à son essence (Guérison, cure radicale : Guérison complète, qui a détruit le mal dans sa racine). 3°) (Familier) Qui est absolu, qui va jusqu’au bout de ses opinions (Refus radical. Réforme radicale). 4°) (politique) Qui préconise l’application intégrale de certains principes (Le parti radical, Républicain radical). Donc, dans radical il faut retenir l’aspect absolu sans dévier de sa ligne, sans compromissions. Nous constaterons pendant longtemps que ce qualificatif est en effet parfaitement adapté à l’esprit de ce parti politique.

Mais revenons au déluge. Le parti radical s’est appelé antérieurement « parti républicain radical et radical socialiste » et même à l’origine « parti républicain radical ». Il faut bien entendre ici la notion de républicanisme radical.
Le parti radical est le plus ancien parti de France. Les radicaux existent idéologiquement depuis le début du XIXe siècle, avec de grandes figures politiques, comme par exemple Ledru-Rollin et Louis Blanc. Le nom radical vient du fait que ce courant de pensée regroupait les républicains radicaux, qui cohabitaient au parlement avec les républicains modérés, les républicains ralliés et les trois courants monarchistes. C'est le premier grand parti politique à l'échelle nationale fondé en France. Jusque là, en effet, il n'existait que des groupes parlementaires de différentes tendances politiques et des comités électoraux locaux aux conceptions encore plus variées. L'idée de réunir au niveau national, dans un même parti des élus et des militants de même tendance, était un concept révolutionnaire. Vue sa conception idéologique l’opposant aux monarchistes et au républicains modérés, c’était à l’origine un parti d’extrême gauche.
Sa philosophie politique sera tout au long de son histoire fortement influencée par la franc-maçonnerie dont seront membres plusieurs des figures politiques radicales.

En 1843, sous la Monarchie de Juillet, il se regroupe autour d'Alexandre Ledru-Rollin et participe à l'avènement de la IIème République. Il soutiendra les grandes réformes de 1848 : instauration du suffrage universel, abolition de l'esclavage, liberté de la presse, droit de réunion.
A la même époque, les radicaux subissent une première déstabilisation idéologique. Les mouvements
socialistes commencent à fleurir et détrônent le parti radical de son statut d’extrême gauche. Ce qui est en fait plus pour une raison de principe théorique que pour une plus faible conviction
dans l’idéologie. Nous en reparlerons quand nous analyserons les mouvements socialistes. Plus tard, l’apparition des communistes puis des gauchistes les repousseront de plus en plus vers le
centre et le centre droit.

Pour l’heure, les radicaux s'opposent au régime de Napoléon III et trouvent un leader, en 1868, en la personne de Léon Gambetta qui, en 1870, proclame la République à Versailles après la défaite de l'Empire face à la Prusse. Les radicaux devront cependant composer avec les monarchistes et les républicains modérés, qui seront hissés à la tête de la France suite aux élections législatives. En effet, le radicalisme est ressenti comme un courant de pensée trop progressiste par les électeurs des zones rurales qui lui préfèrent une monarchie modérée garante à leurs yeux d'une plus grande stabilité politique. La IIIe République installée définitivement depuis 1884, les radicaux incarneront particulièrement l'anti-cléricalisme et l'opposition à l'expansion coloniale de la France. Le Radicalisme possède une vision spécifique de l’organisation sociale et humaine fondée sur la primauté de l’individu. Il prend sa source dans l’histoire même de la République à laquelle il est étroitement lié. La profession de foi du radicalisme est composée de cinq points : « Laïcité, Solidarité, Humanisme, Tolérance, Universalisme ». Cependant, les positions radicales de ce parti étant en discordance avec la crainte de heurter les électeurs (surtout ruraux) ceci les conduira à pratiquer une politique hésitante, en fonction des évènements sans suivre de vrais programmes organisés et, en définitive, avec les mêmes travers que les modérés qu’ils vilipendaient en les taxant d’opportunisme. Le qualificatif d'«opportuniste» fut lancé péjorativement par le journaliste Rochefort et par les radicaux. Les «républicains de gouvernement» (selon l'expression de Ferry), tirant les leçons des longues années d'opposition, voulurent rassurer l'opinion et les milieux d'affaires. Fortement imprégnés de positivisme, ils pensèrent accomplir les réformes nécessaires les unes après les autres. En fait, la pratique gouvernementale les conduisit à s'éloigner de ce qu'ils se proposaient d'accomplir à la fin du Second Empire. Les Radicaux, avec tout leur radicalisme eurent tendance à pratiquer de même. Pourtant, malgré cela, à partir de 1901, le parti radical insiste sur l'union à gauche, la nationalisation des grands monopoles (ce qui les place plus à gauche que les socialistes), la séparation de l'Église et de l'État et la création d'un impôt égalitaire basé sur le revenu.
Il prône une politique laïque et anticléricale, qui amènera les lois de séparation de l’Église et de l’État. Il vante la propriété privée : en effet, les radicaux voient dans l’accession des salariés à la propriété le remède aux problèmes de la société industrielle.
Durant l’entre deux guerres, les idées qu'il défend, constituent un ensemble dans lequel se reconnaît une grande partie des français. Tout d’abord, un attachement profond à la nation et au régime républicain, identifié au système parlementaire, ensuite une conception de la République qui intègre de manière indissociable la laïcité sans sectarisme, érigé en l’un des fondements de la République, dont l’instruction dispensée par l’école est le moteur du progrès social. Le tout est mâtiné d’une conception humaniste de la société et de la politique.
Mais ce qui fait la curiosité de cette période d’entre deux guerres, sur le plan national c’est la volte-face politique soudaine du Parti radical à la charnière des années trente. Il reste, et le revendique, un parti de gauche, ce qui l’amène tout naturellement à pratiquer la "discipline républicaine" des désistements réciproques au profit des socialistes. Mais, au gouvernement, il se comporte en parti du "juste milieu", capable de regrouper autour de lui la majorité des Français attachée à une République traditionnelle et modérée, loin des extrêmes, qu’ils soient réactionnaires ou révolutionnaires. Après avoir dirigé le gouvernement du Cartel des gauches (1924-1926), et participé à l’élaboration et à la mise en place du Front populaire en 1936, c’est lui qui l’enterre en 1938. Cette politique antinomique pousse le Parti radical, lorsqu’il est au pouvoir, à l’immobilisme par la contradiction permanente entre sa majorité et sa politique. Lorsqu’il tente de sortir de cet immobilisme, les gouvernements sont aussitôt renversés. L’issue de cette paralysie politique est l’émeute d’extrême droite et assimilés du 6 février 1934 : les radicaux sont chassés du pouvoir au profit de la droite.
En résumé, les membres du parti sont tentés par une politique de gauche mais le parti, au gouvernement, pratique très souvent une politique de droite !
Tout cela amènera Édouard Daladier à négocier les accords de Munich (laisser les mains libres à Hitler) et à les faire accepter par son parti. A la suite de la débâcle de juin 1940, la majorité des parlementaires du parti radical, comme la plupart des parlementaires, votent le 10 juillet 1940 les pleins pouvoirs au maréchal Philippe Pétain, toutefois, une minorité s'y oppose et rédige une protestation contre la dictature qu'elle prévoit. Une grande partie des 80 parlementaires qui ont refusé de voter les pleins pouvoirs sont des radicaux.

Sous l'occupation, de nombreux radicaux sont victimes du régime de Vichy qui cherche des responsables de la défaite parmi les anciens ministres de la IIIe République. Édouard Herriot est démis de son mandat de maire de Lyon. Édouard Daladier subit le procès de Riom. Jean Zay et Maurice Sarraut seront assassinés par la Milice. Plusieurs radicaux se lancent résolument dans la Résistance, tel Jean Moulin ou Pierre Mendès France, même si, en même temps, une frange du parti radical apporte son soutien à Philippe Pétain ou Pierre Laval. Après la seconde guerre mondiale, Le parti radical espérera un moment retrouver son statut d’avant 1939 mais il n’y parviendra jamais.
En 1969, Jean-Jacques Servan-Schreiber prend la tête du parti et donne un nouveau visage emblématique aux radicaux. Mais lors du congrès de Suresnes (15-17 octobre 1971), deux logiques s'affrontent : celle de Jean-Jacques Servan Schreiber, partisan d'une stratégie d'alliance d'un centrisme réformateur (431 voix), et celle de Maurice Faure, partisan d'une union à gauche (237 voix). En 1972, une partie suit donc son leader en adhérant au Mouvement réformateur (c’est à dire à ce qui, plus tard deviendra l’actuel MoDem), l'autre créant sous la direction de Robert Fabre le Mouvement des radicaux de gauche (MRG), signataire du programme commun.
Dès lors, les deux partis se réclament héritiers du Parti radical, le Parti radical dit « valoisien », majoritaire donc légalement successeur, et le Parti radical de gauche, qui prétend être l'héritier politique. Ces deux branches restent cependant liées en formant au Sénat le Rassemblement démocratique et social européen.
De ce long verbiage, il ressort que le parti radical, après avoir été longtemps le parti de l’extrême gauche et avoir été le fer de lance de tous les grands progrès sociaux de la troisième république, est devenu un parti de centre droit d’une part en raison de ses politiques de capitulation successives et d’autre part en raison des différentes formations qui peu à peu se sont décantées à sa gauche.
De nos jours, les deux partis radicaux n’ont plus une grande influence même s’ils sont encore le support de notabilité du moment (Madame Taubira pour les radicaux de gauche et Monsieur Borloo pour les Valoisiens). En fait, on peu se demander qui sert de support à l’autre. Pour l’un comme pour l’autre, se déclarer membre d’un parti tellement affaibli leur permet de se donner une image politique sans pour autant prendre de position bien nette.
De nos jour, le parti radical, même s’il à sous tendu les aspirations les plus généreuses du dix neuvième siècle n’est plus guère que le souvenir sentimental d’un passé glorieux.
LES PARTIS
Petit tour d’horizon de l’existant.
Les Verts.

Tenez, pour commencer, je vais vous raconter une petite anecdote. Depuis que j’ai commencé à écrire cette série d’articles sur les partis politiques existants, c’est à dire plus d’un mois, vous imaginez bien que j’y réfléchis et que j’essaie de formaliser mes idées un peu disparates. En fait, je passe le plus clair de mon temps de disponibilité à organiser ma vision des choses. Comme j’en étais rempli déjà un bon moment avant de commencer à écrire, cela représente plusieurs mois de réflexion. Tantôt l’un, tantôt l’autre. Essayer de synthétiser ce que je pense de chacun et comment je les comprends. Et bien, je me suis aperçu il y a à peine quelques jours (trois ou quatre) que j’avais complètement oublié les Verts. Je ne sais pas, la couleur, peut-être. Obscurément, je devais avoir l’impression qu’ils n’étaient pas mûrs, qu’il fallait attendre, qu’il n’y avait rien, là dedans, que l’on puisse récolter. Depuis, quand je repense à ce dérapage, je ris et je me dis que cela représente bien l’importance que j’accorde à ce parti. Je sais, en disant ceci, une nouvelle fois, je ne vais pas me faire que des amis. Mais que voulez vous que j’y fasse. C’est comme ça.
Bon, alors, les zélateurs des verts, ne lisez pas plus loin, je vais vous faire de la peine. Non, non ! Restez-en là ! Sinon, vous allez me retirer votre amitié. Or, ça, précisément, je n’y tiens pas.
Depuis, bien sûr, je me suis occupé à rattraper le retard et je me concentre sur le sujet intensément… Ce que j’ai trouvé n’est pas contradictoire avec ce qui précède.
Bien que la pensée écologique soit ancienne, et je vous renvoie en cela à « Contre les bûcherons de la forêt de Gastine » de Pierre de Ronsard (1524 1585). Je vous en laisse un petit extrait pour le plaisir.

Escoute, Bucheron (arreste un peu le bras)
Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas,
Ne vois-tu pas le sang lequel degoute à force
Des Nymphes qui vivoyent dessous la dure escorce ?
Sacrilege meurdrier, si on pend un voleur
Pour piller un butin de bien peu de valeur,
Combien de feux, de fers, de morts, et de destresses
Merites-tu, meschant, pour tuer des Déesses ?
La participation des écologistes à la vie politique française remonte aux années 1970, la date symbolique étant celle de 1974, avec la candidature de René Dumont à l'élection présidentielle.
A l’heure actuelle, les écologistes participent à toutes les élections.
Bon, essayons de nous y retrouver.
D’abord, il est bien entendu que les problèmes écologiques, la destruction massive de l’équilibre
climato-biologique terrestre par l’espèce humaine sont une évidence première.

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l’équilibre chimique qui règne sur la planète terre n’est pas une chose stable. Pendant l’ère primaire, on sait que la composition de l’atmosphère (répartition de l’oxygène et de l’azote) était notoirement différente et incompatible avec la vie. L’apparition de l’animal humain n’est que très tardive. Pour tenter de vous donner une image, je vais faire une comparaison dont, pour simplifier les calculs, je vais arrondir les nombres à l’avantage de l’ « homme ». Si on admet que l’âge de la terre est voisin de quatre milliards d’années et que les préhomminiens apparaissent il y a environ quatre millions d’années, cela veut dire que la présence de l’individu humain ne représente qu’un millième de la durée de l’existence de la terre. Si vous voulez, si on rapporte cela à la vie d’un homme de quatre vingts ans, c’est juste un peu moins que le dernier mois de sa vie. On peut donc dire que la présence de l’homme sur la terre est un épiphénomène.
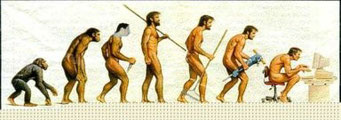
D’autre part, depuis l’apparition de l’homme, on sait que les conditions climatologiques on fluctué de façon remarquables. L’homme de Neandertal, qui vivait dans l’actuelle Allemagne moyenne, profitait d’un climat subtropical (les conditions climatiques d’Alger, quoi). En revanche, l’homme de Cro-Magnon, au sud du massif central subissait un climat sub-polaire et chassait le renne. Les quatre grandes glaciations de l’ère quaternaire (je rappelle que l’ère dite quaternaire n’est pas caractérisée par des modifications géologiques importantes mais simplement par l’apparition de l’homme) sont bien connues. Entre celles-ci, des périodes de réchauffement important sont repérables. A une échelle plus facilement mesurable, on parle même de la mini glaciation du dix-septième siècle. A cette époque, les glaciers de la vallée de Chamonix descendent jusqu’à l’Arve et pour se rendre à Chamonix, il faut franchir le glacier des Bossons. Des gravures de l’époque en attestent. Ces manifestations ont nécessairement joué sur le niveau des océans, la flore et la faune. Il faut donc relativiser les choses.

En revanche, il est clair que l’animal humain influe remarquablement sur son environnement en le détruisant. Il n’est pas le seul. Certaines plantes (la menthe, par exemple) puisent dans le sol des éléments nutritifs qui leur sont indispensables. Le sol épuisé elles se déplacent un peu plus loin grâce à des racines traçantes et la partie abandonnée est, pour elles, devenu stérile. Cependant, les destructions des humains sont sans commune mesure avec toute autre espèce vivante (végétale ou animale).

Avec la révolution industrielle et vers jusqu’au milieu du vingtième siècle, l’image de l’économie triomphante était donnée par des gravures ou des photographie d’usines aux multiples cheminées crachant une fumée lourde, noire et épaisse. Pour les hommes, les rivières, les lacs, voire les baies maritimes devenues biologiquement mortes par les effluents de déchets industriels ne se comptent pas. La mer d’Aral est en train de se vider parce qu’on prend trop d’eau dans le Sir Daria et l’Amou Daria pour irriguer des champs de coton cultivés dans un ex désert. Suite à la création du lac Nasser en Egypte, le delta du Nil est en train de disparaître et je vous passe d’autres bévues du même ordre.
Il est entendu que l’augmentation de la quantité de dioxyde de carbone dans l’air est notoire, que la couche d’ozone subit des modifications préoccupantes, que les manifestations de « El niño » se multiplient et que des territoires sont en train de disparaître sous la montée des océans. Si on ajoute à cela l’augmentation des radiations nucléaires dues aux essais militaires du dernier demi siècle, on peut se demander si les hommes ne sont pas en train de jouer les apprentis sorciers.

Il ne faut pas perdre de vue, au passage, que toutes ces exactions sont liées à une course au profit. Ça coûte tellement moins cher de balancer les déchets d’une mine de nickel dans un lagon que de les remettre où on les a pris !
Tiens, curieux ! Y aurait-il un problème de gros sous là dedans ?
Cela suffit-il à justifier la création d’un parti politique ?
Non.
A mon avis, c’est absurde.
Je vais vous expliquer pourquoi.
Qu’il faille veiller, pour éviter que des gens mal informés ne commettent des exactions écologiques, c’est une douce évidence. Que des personnes conscientes s’élèvent contre de tels abus, c’est non seulement une nécessité, mais un devoir civique. Que ces personnes se regroupent en associations et en groupes de pression pour influer sur les décisions des politiques, c’est constructif et intelligent. Aller voir, en délégation, le député du coin en lui remettant une pétition l’informant que, s’il ne fait pas prendre, d’urgence, une décision contre telle ou telle entreprise qui déverse impunément des effluents toxiques dans la rivière, non seulement, la prochaine fois, on ne votera pas pour lui, mais, de façon délibérée, pour son adversaire, c’est une œuvre de salubrité publique. Que ce qui est vrai, au niveau local, le soit aussi au niveau régional, national et voire international est une forme de cohérence avec la vision que l’on a de l’avenir de l’humanité. Il n’en reste pas moins que vouloir se substituer au politique et s’ériger soi même en autorité décidante est une aberration. Si l’on veut que la machine fonctionne, il importe que chaque pièce soit à sa place.
Tenez, en caricaturant à peine, c’est comme si, considérant que la justice présente de graves lacunes on inventait un parti de la justice. De même, pourquoi pas un parti de l’éducation, un parti des droits de l’homme et de fil en aiguille, un parti des notaires ou des arbitres de football.
Qu’un élu soit conscient des problèmes d’environnement voire adhérant à une association écologiste, c’est bien ! Mais, élire un individu sur le seul critère écologique, c’est inepte. Bah oui, quelle seront ses positions quand on parlera de justice, d’éducation, de droits de l’homme, d’acte notariés ou de football ?
Vouloir gérer la planète uniquement en fonction de problèmes environnementaux, cela revient à ignorer tous les autres, voire à les nier. Ce ne sera pas grave les génocides (comme au Ruanda) du moment que les arbres poussent bien.

Passons à quelques autres travers de ce parti politique. Les verts se veulent apolitiques. Pendant longtemps, leur slogan a été « ni droite, ni gauche ». Un parti politique apolitique, déjà, moi, ça me fait un drôle d’effet. Mais prenons seulement le sens des mots. Du grec ancien πόλις (polis) qui veut dire cité, peuple avec le suffixe « –ique » qui en fait un adjectif ayant le sens de concernant le peuple ou la cité. Donc, politique veut dire qui a rapport aux affaires publiques, au gouvernement d’un État, ou aux relations mutuelles des divers états. En conséquence, un parti politique, c’est un parti qui envisage de s’occuper des affaires publiques, de l’état et des relations entre états. Un parti apolitique, c’est un parti qui ne veut pas s’occuper de tout ça. Alors un parti politique apolitique, je ne sais pas, j’ai du mal à comprendre et même à imaginer. Mais, sûrement que je ne suis pas très futé.
De plus, cette position apolitique vole elle même en éclats. Cette ligne politique est abandonnée en 1994 à l'Assemblée générale de Lille, les Verts décident alors d'accepter de passer des alliances dès le premier tour pour les élections législatives et de ne passer ces alliances qu'avec la gauche. C'est la fin du "ni, ni" qui mettait à égalité la droite et la gauche. Contrairement à ce qui est fréquemment affirmé, les Verts n'ont pas décidé de leur ancrage à gauche au sens où ils s'inscriraient dans cette famille politique, mais au sens où ils considéraient leur idéologie comme incompatible avec celle de la droite. Ils revendiquent l'héritage du combat de la gauche démocratique pour la justice sociale et la liberté, et jugent celui ci incompatible avec le dogme économique libéral. Pourtant, Dominique Voynet, qui s'est beaucoup battue pour faire accepter la politique d'alliance à gauche, reviendra à la charge en déclarant pendant sa campagne présidentielle de 1995 qu'elle n'est "ni catho ni de gauche" mais écologiste.
En raison de sa mise en minorité et des conflits internes assez durs qui la suivent, Antoine Waechter quitte les Verts pour fonder le Mouvement des écologistes indépendants en 1994. Auparavant, des écologistes souverainistes avaient quitté les Verts en 1993 et fondé la Confédération des écologistes indépendants. Donc les fondateurs, si je comprends bien, souhaitaient un ni droite ni gauche à condition d’être plutôt à droite.
Ouais…
Reste une question : qui sont les verts ? D’ou viennent-ils ?
J’en vois trois grandes familles.
D’abord, une partie est la descendance et l’héritage du mouvement hippie des années soixante cinq à soixante quinze
auxquels sont venus se greffer les post soixante-huitards. Cette seconde composante apportait dans ses valises des personnalités qui s’étaient décrites, elles mêmes, comme d’extrême gauche mais
qui, somptueuse stature de matamore, n’avaient de « gauchien » que l’illusion de se persuader qu’ils étaient de grands révolutionnaires (alors que même en 1848, il auraient été déjà
largement dépassés) et d’extrême que leur rejet méprisant pour les luttes précédemment menées par les autres. Ils ont un désir vague de refaire le monde mais refusent l’action politique
réelle.

Ils vivent dans un refuge de religions autres et exotiques et même si le mouvement hippie à apporté
beaucoup dans la libération individuelle des mœurs et des comportements en rejetant aussi la société de consommation, leur impact n’a atteint qu’une petite frange de la population. Certains (pas
tous) qui ont eu le courage de pousser leur théorie jusqu’au bout sont allés jouer aux « Robinson Crusoe » ou aux villageois de l’age du fer dans des hameaux des Cévennes
abandonnés depuis longtemps. Leurs intentions n’étaient pas condamnables, mais il leur manquait les outils technologiques et les savoir faire indispensable pour transplanter leurs illusions
passéistes dans le vingtième siècle.

Ils avaient essentiellement contre eux le fait d’avoir une représentation de la nature et de la vie
rurale qui tenait surtout d’un romantisme citadin d’opérette. Il est à noter qu’après avoir cru vivre de quelques chèvres sur le Larzac ou sur le causse Méjean, la plupart a réintégré les grandes
villes et s’est fondue dans ce que l’on a appelé par la suite les « bobo » (bourgeois bohèmes). Leur origine sociale et leurs options à propos des partis politiques explique bien leur
position, dans le fond, parfaitement conservatrice. « Peace and love » était un credo merveilleux, mais, précisément, il relevait du credo et du merveilleux. C’est un vœu pieu idéaliste
mais pas une doctrine politique. Il est plus facile de semer des petites fleurs psychédéliques un peu partout que de se demander d’où viennent les difficultés.

Et si par hasard et par inadvertance on se la pose, cette question, il est bien entendu qu’il est hors de propos de remettre en cause les fondements de la société. Afficher un refus individuel, cela évite de s’insérer dans des organisations revendicatives et de remettre en cause globalement les mécanismes de l’injustice sociale et de ses spoliations.
Etant entendu que les grands progrès, ne peuvent pas être le fruit d’une organisation conservatrice, il est de bon ton,
afin de s’auto-valoriser, de se donner des allures d’intellectuel progressiste libéré de toutes traditions politiques et au dessus de deux siècles de réflexion.

Il est facile en occultant volontairement les problèmes socio-économiques de se donner des grands airs de précurseur combatif et militant et de se faire passer pour novateur noble et généreux mais avec ce discours limité, voire mutilé, qui trompe-t-on le plus ? Les populations, ou soi même ?
Constatant que, le plus souvent, les monstruosités environnementales sont liées à une course au profit maximum immédiat, imaginer que l’on résoudra les problèmes politico-socio-économiques de la planète en résolvant des incohérences écologiques et non pas le contraire relève pour moi d’une pantalonnade saugrenue.

Hélas, il est plus facile et moins dangereux d’arborer un costume pseudo naturel et de débiter des clichés sur la paix dans le monde que de s’attaquer aux responsables mêmes de ce que l’on stigmatise.
Même si les grands partis et les grands moments révolutionnaires n’ont pas apporté ce qu’on pouvait en espérer, les rejeter généralement sans, d’une part, essayer de comprendre par où ils ont pêché et, grâce à l’expérience y apporter des correctifs et, d’autre part, sans en tirer des enseignements positifs, n’est en définitive qu’une position obscurément réactionnaire.
De toute la diatribe qui précède, il en découle la deuxième grande famille composant ce parti des verts.
Le parti des verts étant, comme nous venons de le peindre, tout ce qu’on veut sauf un parti politique
révolutionnaire, et même un parti politique tout court, cela a permis à des nostalgiques de la démocratie chrétienne en manque de drapeau présentable de s’y jeter.
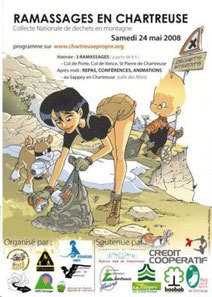
En effet, l’esprit « jaune » de collaboration de classe cherchant à se couvrir d’une image conquérante et généreuse a trouvé confortable et porteuse cette mouvance de non parti non politique et non dénonciatrice de la caste accapareuse.
L’écologie devient une mine de bonnes actions ou les âmes éthérées peuvent satisfaire leur besoin de répandre, à titre individuel, le bien autour d’elles. Après avoir tricoté des chaussettes pour les pauvres, on va sauver l’environnement. Le sommet de la valorisation narcissique sera atteint lorsque, une fois ou deux par an, on revêtira son joli petit ensemble faussement sportif et qu’on ira, avec un air de bonne conscience supérieure, et de bonhomie condescendante, encadrer les braves gens que l’on a circonvenus, en chantant des psaumes dans une procession émue, ramasser, dans les fossés de la commune, les papiers sales et les capsules de bouteilles. La cérémonie s’achèvera autour de l’autel d’un pic nique collectif au cours duquel on désignera les méchants hérétiques que faute de bûcher pour en faire un « auto da fe », on nommera haut et fort afin de les jeter en pâture à la vindicte populaire pour leur incivisme notoire.
Et c’est à peine si j’exagère.
Un peu quand même ?
Non, non ! Je vous assure et je dirais même que la réalité dépasse la fiction.
Et puis, bien sûr, il y a la troisième famille.
Je dirais que c’est, à mes yeux, la plus sympathique.

Ce sont tous ceux qui déçus par la droite comme par la gauche mais ne voulant pas abandonner leur droit de vote, espérant autre chose, acceptant le sacrifice qu’ils font pour le bien être futur et hypothétique de leurs enfants, par défaut, se réfugient dans cette option qui, faute de projets réels, donne au moins l’illusion d’agir dans l’immédiat et de peser sur une réalité désolante et sordide.
Quoi qu’il en soit, et toutes familles confondues, j’ai l’impression que le parti des verts, par crainte d’affronter les problèmes fondamentaux, préfèrent poser le problème à l’envers.

Juste un mot avant de passer à la suite. Voisins des Verts, il y a les alter-mondialistes dont je ne parlerai pas puisque eux, au moins, ont eu la sagesse de ne pas s’ériger en parti politique. Cependant, j’ai l’impression qu’ils ont une vision de la vie sur la planète qui est plus globale et plus responsable quand aux analyses qu’ils en tirent. Il est, au demeurant un peu tôt pour se faire une idée précise de cette ondoyance balbutiante. Nous en reparlerons dans quelques années.
Bah dites donc, je n’y avais pas pensé avant, à ce parti, mais quand je me suis mis à y penser, je crois que j’ai rattrapé mon retard.
En littérature, prendre la cause pour l’effet ou le contraire :
Cela s’appelle une métonymie.
C’est fort quand c’est fait exprès.
Par inadvertance…
Je ne sais pas.
LES PARTIS
Petit tour d’horizon de l’existant.
LE PARTI SOCIALISTE
(Première partie : l’opposition)

STOP !
Oui, je crie :
STOP !
Si je continuais ma description des partis existants comme cela sur ma lancée, j’aurais tord. Ce serait une erreur.
Je sais, le strict balayage, de droite à gauche, des partis politiques existants en France impliquerait que maintenant, nous parlions du parti socialiste. En revanche, en parler sans, à ce moment là de notre réflexion, insérer des mises au point nécessaires, serait une ânerie et vous seriez les premiers à m’en tenir griefs.

Vous voyez, je ne me suis pas laissé entraîner par mon élan comme vous vous y attendiez et vous ne pourrez pas ricaner dans votre coin en constatant que je ne suis même pas capable de respecter ma propre logique. Avouez que vous m’y attendiez à ce moment là. Hein ! Avouez que vous vous prépariez depuis un moment à me montrer du doigt en vous gaussant grassement de ma bévue.
Mais non, je ne me suis pas laissé précipiter par mon emportement et ma fougue.
Eh, je ne suis pas tombé de la dernière pluie non plus ! J’avais depuis longtemps prévu qu’à ce moment là, il fallait bien montrer la charnière idéologique. Je savais bien que sans cela, non seulement la suite mais aussi l’ensemble devenait incompréhensible.

La charnière, oui, la charnière… Je dirais même la dichotomie fondamentale… Si je ne l’explique pas, tout perd son sens.
Bon, alors, venons-y. Et pour cela, reprenons les choses au début.
D’abord, il nous faut revoir la notion d’opposition. Je sais, je vous en ai déjà parlé, mais comme il y a longtemps, vous avez oublié. Vous voyez comme vous êtes, aussi. Je suis sûr que vous ne prenez même pas de notes. Vous n’êtes pas sérieux, non plus !
Bon, bah, allez-y.
Si, si ! Je vous attends…

Ça y est, vous avez vu ?
Bien. Mais comme je ne suis pas très sûr que vous ayez tout compris, je vais vous ré expliquer autrement.
Vous êtes redoutable, des fois !
A partir du moment où il y a une organisation sociale, il y a nécessairement un système hiérarchique.
On notera que dans une meute de loups, un groupe de lions ou un troupeau d’éléphants, un dominant ou une dominante s’impose par l’expérience et la force.

Non moins nécessairement, cette domination est en permanence remise en cause par des prétendants. L’animal humain étant un animal social, on constate le même phénomène. Simplement, le susdit animal humain présentant des capacités mentales et, donc, organisationnelles plus complexes, le jeu du pouvoir hiérarchique est plus élaboré.
Dans des états monarchiques absolus ou des états totalitaires, l’opposition, se rebellant contre un pouvoir d’essence divine ou sous une autre forme, présentée de façon comparable, est interdite. Du coup, elle ne peut être que clandestine et secrète et, la plupart du temps, violente. On pourchasse les conspirateurs et, la contestation, assimilée au banditisme, est réprimée comme telle. Les révoltes, émeutes et jacqueries on toujours été noyées dans le sang.

En revanche, dans les états qui se veulent démocratiques, l’existence légale d’une opposition est tolérée. Cela ne veut pas dire qu’on ne luttera pas contre elle, mais disons… qu’on y met les formes. Ne perdons pas de vue qu’il ne peut s’agir que d’une lutte opiniâtre et farouche pour la conquête du pouvoir ou son maintient dans celui-ci.
L’existence naturelle de cette opposition étant établie, nous allons essayer de différencier les différentes natures qu’elle peut présenter.
J’en vois essentiellement trois.
La première, la plus simple, c’est celle du loup qui veut être le dominant de la meute en évinçant son
prédécesseur. Dans les mêmes conditions, c’est le chef de clan paléolithique qui impose sa force aux autres.

C’est le prétendant au trône qui renverse le roitelet par une conspiration de palais. Ce sont les maquignonnages au sein de certaine partis politiques pour en acquérir la direction à des fins personnelles ou intéressées en vue d’autres élections nationales. Ce sont les élections primaires au Etats Unis. Selon une expression consacrée dans une bande dessinée bien connue, c’est « je veux être Calife à la place du Calife ». Le résultat final ne changera strictement rien à la situation populaire. Il y a quelques décennies, un homme politique français disait du deuxième tour d’une élection présidentielle : « C’est bonnet blanc et blanc bonnet ». Bien que chaque prétendant entraîne derrière lui une horde de défenseurs, c’est une stricte opposition de personne.
Le deuxième modèle, s’il présente souvent les caractéristiques du premier : est agrémenté d’une variante.

Cette fois-ci, on va prétendre soutenir des options
différentes. En caricaturant à peine, l’un dira qu’il faut vendre des carottes pour acheter des crayons à bile et l’autre s’élèvera véhémentement contre cette position scandaleuse et révoltante
en clamant qu’il est clair qu’il vaut mieux vendre des chapeaux pour acheter du poisson. On voit tout de suite l’avantage que les citoyens en tireront. Pour ceux qui
n’auraient pas compris, comparons les positions de deux présidents de la république successifs dont l’opposition était bien connue.

François Mitterrand, pour affirmer une allégeance aux Etats Unis dont il espérait tirer avantage participe à la première guerre du golfe et par ailleurs, dans la même intention, son successeur déclare en Israël que les palestiniens sont des terroristes. Monsieur Jacques Chirac choisit l’option inverse. Il ne participe pas à le seconde guerre du golfe et déclare dans la partie musulmane de Jérusalem qu’ici, il n’a que des amis en menaçant le service d’ordre israélien qu’il trouve trop envahissant de reprendre son avion. Il se démarque donc de la soumission aux Etats unis, et espère ainsi se garder des sympathies et des marchés dans le monde arabe.

Bien que j’aie, personnellement, une petite préférence dans le cas de figure, cela change-t-il quelque chose dans la vie quotidienne de la ménagère de moins de cinquante ans ?
Cette opposition, je l’appellerais volontiers stratégique ou tactique.
Arrivons-en au troisième type d’opposition.
Cette fois-ci, la situation est toute autre.
Comment me faire comprendre ?
Il ne s’agit plus d’une stricte opposition entre individus ; il ne s’agit plus d’une opposition de tactique gouvernementale, mais d’une opposition dans la vision que l’on a de la société.
Allons ! Mais, ce n’est pas possible ! Me rétorquera-t-on ! La société humaine est comme elle est et on n’y peut rien ! Vouloir la modifier relève de l’utopie !

En êtes-vous si sûrs ?
Les gens qui vivaient avant mille sept cent quatre vingt neuf disaient la même chose. Il n’était pas pensable que la société ne soit pas divisée en trois classes (ou ordres). Il n’était pas pensable que l’organisation de la vie ne soit pas gérée (pour le bien de tous) par un monarque de droit divin. Il n’était pas pensable que des individus ne jouissent pas de privilèges par rapport à d’autres (impôts, droit de chasse, couleur des vêtements, droit de basse et haute justice, droit sur les héritages etc.) Il n’était pas pensable que « les hommes naissent libres et égaux en droit ». Il n’était pas pensable d’abolir la torture judiciaire, Il n’était pas pensable qu’il n’y ait pas une religion officielle obligatoire.
Tout cela n’était pas pensable. Et pourtant…
Il faut bien se persuader que toutes ces choses qui, aujourd’hui nous semblent monstrueuses étaient normales et considérées comme normales par l’ensemble de la population.
La société était de type féodal et son bien fondé était reconnu par tous. Certes, dans les derniers temps, certains mauvais esprits avaient la fâcheuse tendance d’émettre des doutes. Ils étaient très mal vus et facilement embastillés. En revanche, ces mauvais esprits, fort cultivés, ont eu le mauvais goût d’écrire leurs visions du monde et de théoriser. Leurs idées se sont répandues dans la société instruite d’abord puis de plus en plus chez le commun des mortels en suivant grossièrement le chemin décroissant de l’instruction et de la conscience politique individuelle du statut de chacun.
Le résultat a été ce que l’on sait.

Il ne s’est plus agi de modifications quantitatives (un peu plus de ceci, un peu moins de cela). Non, la modification a été qualitative. On est passé d’un système féodal à un système bourgeois (plus tard rebaptisé pour des raisons dont nous parlerons peut-être un jour capitaliste). On ne s’est pas contenté de moderniser ou d’humaniser une organisation existante, non, on a changé d’organisation. La partie devenant, avec le temps injouable, on a considéré que changer d’arbitre était insuffisant, on a changé la règle du jeu.
Si on ajoute que, longtemps avant, une mutation du même type s’était déjà produite, certes dans des circonstances moins violentes et moins rapides mais avec des conséquences également très importantes la société antique esclavagiste s’est muée en société féodale de servage, il n’y a aucune raison de penser qu’une transformation de ce genre ne soit pas encore possible. Et même, que plus tard, d’autres dont nous n’imaginons même pas les prémices se produisent à leur tour.
Dans ces cas, la société opère comme un retournement sur elle même pour repartir sur d’autres bases. Et, ce retournement, c’est, très précisément de qui s’appelle une révolution. Nous en reparlerons un autre jour, mais affirmons déjà maintenant que ce n’est pas parce que certaines révolutions on été violentes que toute révolution doit l’être. Signalons, à ce titre, la révolution dite « des œillets » au Portugal le 25 avril 1974 qui mettait fin à une dictature de plus de trente ans. Eh, vous m’accorderez que mettre des fleurs dans les fusils et les canons, c’est d’une violence toute relative !
Une révolution, ce n’est pas une évolution, mais une mutation.

Avec ce nouveau genre d’opposition, la question n’est plus de quelle couleur on va repeindre l’immeuble mais de se demander s’il ne serait pas urgent et pertinent de le raser et d’en reconstruire un autre différent. Comme dit la chanson bien connue : « du passé faisons table rase ».
Il va de soi que cette nouvelle forme d’opposition s’oppose aux deux précédentes et est strictement inconciliable avec elles.
Cette nouvelle façon de penser apparaît dès le début du dix-neuvième siècle ? C’est un résultat secondaire de la révolution de 1789. En effet, ces évènements, qui avaient arraché le pouvoir totalitaire à l’aristocratie terrienne et militaire en s’appuyant massivement sur les populations, avaient, en définitive, déçu puisqu’ils n’avaient fait que transférer ce pouvoir à une autre aristocratie financière et industrielle quasi aussi totalitaire.

Dès lors, prenant acte de l’avancée de cette révolution que l’on qualifiera de politique, des intellectuels vont s’interroger pour déterminer les modalités nécessaires afin que cette révolution politique atteigne son aboutissement en se doublant d’une révolution sociale. A l’issue de banquets républicains, il était de bon ton de lever son verre en s’écriant « A la sociale ! ». C’est la raison pour laquelle on les appellera les socialistes.
Théoriquement, je l’ai déjà dit, une opposition socialiste est inconciliable avec toute autre forme d’opposition. Même si dans la pratique, c’est un peu moins vrai, les partis conservateurs ne s’y sont pas trompés et pendant longtemps, le rêve de ceux-ci a été de réaliser une union sacrée de toutes les tendances non socialistes. Simplement, ils n’y sont que très rarement parvenu qu’à cause, entre eux, des autres oppositions déjà décrites.
Nous avons vu qu’il y avait des oppositions de personne, des oppositions tactiques, celle-ci est théorique ou idéologique.
Le problème n’est plus : Comment gérer l’état pour proroger la situation existante (au profit de quelques puissances financières) en lui donnant un vernis social apparent, mais comment réaliser un état garantissant un fonctionnement tel que la totalité de la population y trouve ses avantages propres.
Vous comprenez, maintenant pourquoi je ne pouvais pas, d’emblée, sans ces prolégomènes vous faire la description du parti socialiste.
Vous vous dites : « Bon, ça y est. Maintenant, ça, c’est fait et la prochaine fois, nous allons y avoir droit »

Erreur !
Avant de vous présenter le parti socialiste, il va falloir encore que je vous rafraîchisse la mémoire sur « les socialismes ».
Et puis, tenez, pour la route et pour patienter une semaine, je vous redonne quelques vers de la chanson déjà évoquée. Ce n’est qu’une chanson, mais ses paroles, même si elles expriment, par ailleurs, de façon dialectiquement absurde que cette conquête sera la dernière, sont flamboyantes de rêves et d’enthousiasme.

« Du passé, faisons table rase.
Foules esclaves, debout, debout !
Le monde va changer de base ;
Nous ne sommes rien, soyons tout !»
LES PARTIS
Petit tour d’horizon de l’existant.
LE PARTI SOCIALISTE
(deuxième partie : les socialismes)
C’est amusant, à chaque fois que j’envisage d’aborder ce sujet, je m’aperçois qu’il y a des préalables qu’il faut évoquer. De préalable en préalable, je m’y perds moi même et je reporte la rédaction à plus tard. Alors, foin de tergiversations, c’est décidé, je m’y mets.
En premier lieu, je veux évoquer une dialectique classique dans les discutions de salon. Certains affirment que la société est la résultante des comportements humains et que pour changer la société, il faut d’abord changer l’homme. S’en suivent des volontés moralistes diverses. Les autres soutiennent que les hommes sont le fruit de la société dans laquelle ils vivent. Ceux-ci échafaudent intellectuellement des dispositions sociologiques pour, à terme, modifier le comportement humain.

Ceci me rappelle furieusement le problème de la poule et de l’œuf. Qui a commencé ? Et, en l’occurrence, par quoi faut-il commencer.
A mon avis, ces ratiocinations sont dénuées de sens. C’est une vision fixiste de l’évolution. C’est ignorer la phylogenèse de la reproduction sexuée. Rien que ça.

Il est entendu que l’individu humain dépend de la société dans laquelle il est né, il a grandi, il a été éduqué et formé mais en retour, il influe sur cette même société en lui apportant ses particularités propres. Il s’agit bien d’une dialectique indissociable et insécable. Il n’y a pas de société humaine sans humains et pas d’humains sans société humaine. Vouloir agir sur l’un en faisant abstraction de l’autre est une ineptie. C’est comme si on voulait parler de la pesanteur sans faire référence à Newton (Isaac 1643 1727) ou présenter ce même Newton en omettant ses travaux sur la gravitation universelle. Autre image, c’est comme si on voulait parler de reproduction sexuée ou asexuée sans parler de méiose et de mitose ; ou, réciproquement décrire les phénomènes de réduction chromatique sans penser à la reproduction sexuée.

Ceci me fait irrépressiblement penser à la formule de Zazzo (René 1910 1995) qui dit que, et je cite de mémoire, « l’enfant se caractérise par une vision du monde pointilliste, discontinue et égocentrique ».
Si ne pas voir l’intrication et l’unicité entre humanité et société humaine n’est pas une forme de pointillisme et de discontinuité donc de puérilité, alors, c’est que je suis encore plus bête que je ne le craignais.
Quand je dis puérilité, je pourrais tout aussi bien choisir son équivalent d’origine latine :
infantilisme.

Quoi qu’il en soit, avoir un raisonnement puéril (ou infantile) lorsqu’il s’agit d’adulte, cela dénote un retard mental patent ce que Binet (Alfred 1857 1911), qui ne s’embarrassait pas de circonlocutions et de périphrases bien pensantes, appelait le « crétinisme ».
De ce qui précède, je crois pouvoir affirmer sans crainte que les individus et les groupes d’individus qui, à travers
l’histoire, on réfléchi et tenté de légiférer sur les relations humaines de la société son légion.

Je ne vais pas tous vous les citer, mais je vais vous en rappeler quelques uns pour qui j’ai une tendresse personnelle.
Chronologiquement, le plus ancien connu est sans doute Confucius (551 479 av JC). Considéré comme le premier «éducateur» de la Chine, son enseignement a donné naissance au confucianisme, une doctrine politique et sociale qui a été érigée en "religion d'État".

Un peu plus tard et très loin de là, nous rencontrons Platon (427 346 av JC). Bien que son livre « la république » soit une longue suite de dialogues traitant de la justice, certains y voient une préfiguration d’un communisme surtout basé sur la morale. Toutefois, Platon est un homme de son époque et pour lui, l’esclavage est une « loi de la nature » et il méprise profondément ces mêmes esclaves.

Je saute allègrement un gros millénaire et j’arrive à More (Thomas 1478 1535). Le titre de son livre majeur créera le concept influant la pensée politique jusqu’à nos jours soit environ un demi millénaire. C’est « Utopia ». Si vous ne l’avez pas lu, jetez vous dessus. C’est à la fois court et passionnant. L'utopie, description d’une île imaginaire et de son fonctionnement politique est un néologisme de Thomas More, synthèse des mots grecs ύ-τοπος, nulle part et de ηύ-τοπος, lieu de bonheur. C’est une représentation d'une réalité idéale et sans défaut. Cela se traduit, dans les écrits, par un régime politique idéal qui gouvernerait les hommes parfaitement et une société équilibrée sans injustice. Il est à noter que, curieusement, on trouve dans l’Utopie des notions préfigurant des positions de Marx et ce même Marx en sera suffisamment influencé pour stigmatiser les socialismes différents du sien en les traitant d’utopistes.

Environ vingt ans plus tard, nous rencontrons Rabelais (François 1494 1553) qui dans son abbaye de Thélème dépeint aussi une société idéale où la liberté est de règle (« fais ce que voudras »). Hélas, Rabelais reste marqué par la société féodale. En effet, dans son abbaye de Thélème, pour que les fins intellectuels puissent vaquer à leurs activités distinguées, on se demande qui assume les tâches matérielles.

Et puis, nous arrivons au siècle des lumières. Je rappelle à votre bon souvenir.
Montesquieu (Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de… 1689 1755). La notion de séparation des pouvoirs (entre autres) c’est lui dans « L’esprit des lois ».

Voltaire (François Marie Arouet, dit… 1694 1778). On lui prête cette phrase qu’il n’a pas écrite mais qui lui convient bien : « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » Voltaire, malgré des positions très contestables, c’est la tolérance.

Rousseau (Jean Jacques 1712 1778) : Le discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes et, bien sûr le contrat social devraient suffire à le mettre en bonne place parmi les penseurs politiques. Surtout si l’on ajoute son poids dans la philosophie de la révolution de 1789.

Diderot (Denis 1713 1784). Bien que peu passionné par la politique, il proscrit toute forme de despotisme et réclame un enseignement non religieux.
Tous ces précurseurs, et une foule d’autres auxquels je ne fais pas allusion, indiquent que le problème de l’organisation sociale est vieux comme la civilisation. Cependant, ils ne sont pas, à proprement parler, même si leur influence restera majeure dans ce qui suivra, des socialistes.
On notera au demeurant qu’ils ont tous une préoccupation commune : la justice. Ceci pourrait donner à penser, a contrario, que la société humaine vit depuis les débuts de la civilisation dans une situation chronique d’injustice.
LES PARTIS
Petit tour d’horizon de l’existant.
LE PARTI SOCIALISTE
(deuxième partie : les socialismes, suite)
Il devient urgent, maintenant, de redire ce que sont, a l’origine les socialismes. En France, la révolution a généré de vastes espoirs lumineux. En effet, la bourgeoisie, pour s’emparer du pouvoir a eu besoin de s’appuyer sur les masses populaires. Ce ne sont pas les banquiers et les armateurs eux mêmes qui sont montés à l’assaut de la bastille. Plus tard, face à la coalition européenne de monarques totalitaires, les grands manufacturiers ont eu besoin de chair à canon pour affirmer leur pouvoir. Du coup, les gens utilisés comme masse de manœuvre se sont sentis concernés par cette mutation et investis d’une mission révolutionnaire. La horde inorganisée qui dévala la colline de Valmy ne chargea pas au cri de vivent les bourgeois mais au nom du peuple, de « Vive la nation ! ».
Après 1794, l’orage étant passé, la grande bourgeoisie récupère ses billes et se débarrasse des prétentions du menu peuple.
L’aventure napoléonienne vide de son sens l’armée populaire républicaine et la Restauration peut, un
moment espérer revenir à la monarchie d’avant dix sept cent quatre vingt neuf.

Ces aspirations réactionnaires sont balayées par les trois glorieuses. Cependant, la bourgeoisie qui est désormais expérimentée, si elle a su, une nouvelle fois s’appuyer sur le petit peuple s’empresse de remettre en place un système monarchique. La bourgeoisie ne veut pas d’une république. Elle préfère la monarchie (dite de juillet). Le Roi, qui précédemment s’était fait appeler Louis Philippe Egalité, est un vrai protagoniste de la haute bourgeoisie à laquelle il appartient et dont il a épousé la cause. D’ailleurs, il aime afficher des attitudes et des costumes de cette catégorie sociale et se faire appeler le Roi bourgeois.
Tout ceci a laissé un goût amer aux anciens de 1789. Rappelons que ceux qui avaient vingt ans à cette époque ont maintenant soixante et un ans. Et ceux qui chargeaient à Valmy en ayant moins de vingt ans sont encore plus jeunes. Pour l’anecdote, je vous rappelle une opérette qui un peu plus tard fera chanter « c’était pas la peine, c’était pas la peine, c’était pas la peine assurément de changer de gouvernement ».
Dès les débuts de la restauration, des partis républicains se constituent. Ils sont bien sûr pourchassés par ce qu’on a appelé « la terreur blanche ». Cependant, ils se réunissent en groupes plus ou moins interdits et se manifestent sous le couvert des banquets divers. On considère que la révolution n’est pas arrivée à son terme. On constate qu’il y a bien eu une révolution politique, mais que cette révolution s’est arrêtée avant d’accomplir son volet social. Donc on attend, on espère et on pense préparer une révolution sociale : celle qui parachèvera la précédente. Celle qui sera le grand soir, la lutte finale. A l’issue de ces banquets ou de ces réunions, on s’exclame, comme pour un cri de ralliement : « A la sociale ! ».

De cela va sortir la notion de socialisme. A partir de là, des individus, dans le droit fil de ce qui avait été les lumières du siècle précédent, vont chercher à théoriser ce que devra être ce socialisme. Comme il s’agit de personnalités différentes, les projets seront différents et c’est pourquoi on parle de socialismes au pluriel.
Evoquons en un certain nombre parmi les plus connus et les plus influents.
D’abord un précurseur dès la réaction thermidorienne. François Noël Babeuf, connu sous le nom de Gracchus Babeuf, 1760 an V. Il fomente la «conjuration des Égaux » contre le Directoire et fut exécuté. Sa doctrine, le «babouvisme », est précurseur du communisme.

François Marie Charles Fourier 1772 1837, est un philosophe français, considéré par Marx et Engels comme une figure du «socialisme critico-utopique ». Plusieurs communautés utopiques, indirectement inspirées de ses écrits, ont été créées depuis les années 1830. Il imagine une vie quasi monacale : les phalanstères. Dans la théorie de Charles Fourier, le phalanstère est une sorte d'hôtel coopératif pouvant accueillir 400 familles (environs 2000 membres) au milieu d'un domaine de 400 hectares où l'on cultive les fruits et les fleurs avant tout. Fourier décrira à loisir les couloirs chauffés, les grands réfectoires et les chambres agréables.Sans tricher beaucoup, on pourrait rapprocher cette vision des choses de ce que seront plus tard avec la même volonté d’autonomie, les intentions d’autogestion des entreprises et, en Chines, à l’époque de Mao Tsé Toung les « communes populaires ».

Louis Auguste Blanqui dit l’Enfermé, 1805 1881, était un révolutionnaire républicain socialiste français, souvent associé à tort aux socialistes utopiques. Il s’est battu pour des idées neuves à son époque notamment pour le suffrage universel (Un homme, une voix), pour l'égalité homme femme, la suppression du travail des enfants etc. Il doit son surnom (l’Enfermé) au fait qu'il passa la plus grande partie de son existence (près de 37 années !…) en prison. Il est à l'origine du blanquisme image prémonitoire du communisme. Parmi ses écrits citons : « Qui fait la soupe doit la manger », « De la propriété du sol à l’esclavage », « Évolution de l’esclavage », « La lutte finale ».

Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon(1760-1825) est un économiste et un philosophe dont les idées ont eu une postérité et une influence sur la plupart des philosophes du XIXe siècle. Enfant plutôt turbulent, Claude Henri de Rouvroy reçut de son éducation d'un précepteur les enseignements de d'Alembert et de Rousseau. Adepte des idées nouvelles, le jeune aristocrate s'engage à 17 ans dans l'armée de libération des États-Unis aux côtés de La Fayette et du comte de Rochambeau. Pendant la Révolution française, abandonnant sa particule, Saint-Simon s'enrichit par la vente des biens de l'Église. Pragmatique, il prône un mode de gouvernement contrôlé par un conseil formé de savants, d’artistes, d’artisans et de chefs d’entreprise et dominé par l'économie qu'il convient de planifier pour créer des richesses et faire progresser le niveau de vie. Il appartient aux capitalistes d'œuvrer à l'élévation matérielle et morale du prolétariat.

Pierre-Joseph Proudhon, 1809 1865, le premier à se qualifier d'anarchiste. Proudhon est célèbre pour sa fameuse citation « la propriété, c’est le vol ! ».
La publication de « Qu’est-ce que la propriété?» attire l’attention des autorités françaises mais aussi de Karl Marx qui entame une correspondance avec Proudhon. Les deux hommes s’influencent mutuellement ; ils se rencontrent à Paris où Marx est en exil. Leur amitié s’achève quand, en réponse à « La Philosophie de la misère » de Proudhon, Marx écrit « La Misère de la philosophie ». Proudhon pensait que la propriété collective était indésirable et que la révolution sociale pouvait être atteinte pacifiquement. Pour lui, la propriété manifeste l’inégalité mais est l'objet même de la liberté, le machinisme accroît la productivité mais détruit l’artisanat et soumet le salarié, in fine la liberté elle-même est à la fois indispensable mais cause de l'inégalité. Ces contradictions sont éternelles et n’annoncent nullement l’autodestruction du capitalisme qu'aurait annoncé Marx. Proudhon écrit entre autres choses la fameuse phrase « l’anarchie c’est l’ordre sans le pouvoir ». Il tenta de créer une banque nationale qui donne des prêts sans intérêts, similaire d’une certaine façon aux mutuelles d’aujourd'hui.

Mikhaïl Aleksandrovitch Bakounine, 1814 en Russie 1876 en Suisse, est un révolutionnaire, un théoricien et un philosophe de l'anarchisme. Il pose dans ses écrits les fondements du socialisme libertaire. Je cite Bakounine comme un des pères de l’anarchie (avec Proudhon).

Louise Michel, 1830 1905 est une militante anarchiste et l’une des figures majeures de la Commune de Paris. Première à arborer le drapeau noir, elle popularise celui-ci au sein du mouvement anarchiste.

Karl Heinrich Marx, 1818 à Trèves 1883 à Londres, était un activiste politique, philosophe et théoricien allemand, célèbre pour sa critique du capitalisme et sa vision de l'histoire comme résultat de la lutte des classes, à l'origine du marxisme.
Bien qu’on le ressente souvent comme l’ombre du précédent dont il était un grand ami, évoquons aussi Friedrich Engels 1820 1895 qui fut un philosophe et théoricien socialiste allemand vivant une grande partie de sa vie en Angleterre.
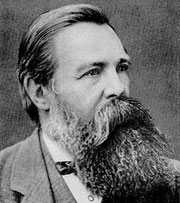
Au printemps 1847, Marx et Engels rejoignent un groupe politique clandestin, la Ligue des Communistes. Ils y prennent une place prépondérante lors de son second congrès à Londres en novembre 1847. À cette occasion, on leur demande de rédiger le Manifeste de la Ligue, connu sous le nom de Manifeste du Parti communiste, qui paraît en février 1848 et dont la dernière phrase est la fameuse exorde : « Prolétaires de tous les pays, unissez vous ! ».
Plus tardivement, nous rencontrons Lénine (Vladimir Ilitch Oulianov) et Léon Trotski dont nous reparlerons plus tard.
De tout ce qui précède, nous pouvons observer une constante. Témoins de la grande misère des ouvriers, émus par leur condition de vie et habités par une remarquable générosité, ils envisagent d’y remédier. Comme dit Marx, le but n’est pas comme pour les philosophes du passé d’observer la société mais de la transformer. Tous sont des théoriciens, des philosophes, des sociologues, des économistes mais surtout des humanistes. Ils sont souvent issus des classes aisées et c’est ce qui explique leur instruction et leur culture. Ils manifestent, de ce fait, un intellectualisme leur permettant de conceptualiser leurs réflexions.
Ces théoriciens on en outre pour la plupart une vision universelle de la civilisation (comme l’on aussi les Radicaux précédemment décrits). Il s’en suit qu’un des résultats, de près ou de loin, de leurs activités est la fondation des diverses internationales.
LES PARTIS
Petit tour d’horizon de l’existant.
LE PARTI SOCIALISTE
(deuxième partie : les socialismes, fin)
La première organisation internationale, fut fondée à Londres en 1855 par des proscrits socialistes français, allemands, polonais, anglais et belges. Elle dura quatre ans et fut dissoute suite aux dissensions de certains membres.
Le 28 septembre 1864, un congrès ouvrier européen se tient au Saint-Martin's Hall de Londres à l’initiative des syndicalistes britanniques. La décision y est prise de créer l'Association Internationale des Travailleurs (qui sera plus tard appelée « Première Internationale ». Elle unit des éléments du mouvement ouvrier de divers pays. Mais, après l’affaiblissement dû à la répression qui suit l’échec de La Commune, la Première Internationale va s'éteindre progressivement.
Quelques années après la disparition de l'AIT, les partis sociaux-démocrates se regroupent dans l'Internationale ouvrière (dite «Deuxième Internationale»), sous l'impulsion notamment de Friedrich Engels. Elle est aussi connue sous le nom d’Internationale Socialiste.
Certains anarchistes furent présents à ce congrès, réclamant le groupement des travailleurs en lutte essentiellement sur le terrain économique, et rejetant la division politique, mais ils en furent exclus pour ces raisons de divergence tactique.
Se fondant, comme la Première Internationale, sur le constat de la lutte des classes, la Deuxième Internationale milite jusqu'au début du XXe siècle sur les bases du marxisme. Mais certains courants se développent à la droite de l'Internationale, prêchant l'abandon du principe selon lequel «l'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes» (principe révolutionnaire qui était celui de la Première Internationale) et recommandant de privilégier le parlementarisme (réformisme).

Après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, les leaders socialistes (à l'exception des Russes et des
Serbes), votèrent les crédits militaires demandés par les gouvernements. Les militants fidèles à l'internationalisme et au pacifisme dénoncent ce
reniement de la majorité, et militent contre la guerre - ce qui leur vaut souvent d'être exclus de la Deuxième Internationale (c'est le cas par exemple de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht en
Allemagne).

Ces militants hostiles à la guerre sont alors appelés «communistes», par opposition à leurs ex-camarades socialistes.
Suite à la Révolution russe, de nombreux socialistes quittent la Deuxième Internationale pour rallier la Troisième Internationale fondée par les communistes russes en 1919, et comportant déjà diverses organisations communistes (notamment les spartakistes allemands exclus pendant la guerre du SPD).
Encore un mot sur la différenciation entre socialistes réformistes et socialistes révolutionnaires. On appelle réformistes des socialistes qui entendent par une succession de réformes, au fil du temps et des opportunités modifier progressivement la société. A l’opposé, on appelle socialistes révolutionnaires ceux qui, considérant que la transformation est qualitative et non quantitative, sont persuadés que la transformation ne peut pas être morcelée. Cette dichotomie serait un sujet intéressant de discussion. Je ne vais pas lancer ma démonstration, mais personnellement, parce que, que voulez-vous, j’ai même des avis personnels, j’ai l’impression que c’est un faux débat et que dans la pratique, les deux cohabitent. D’ailleurs, il est amusant de constater que ce sont, précisément, ceux qui sont révolutionnaires qui soutiennent que les apports quantitatifs finissent par déterminer un changement qualitatif. Disons simplement, quand même qu’en dessous d’un certain seuil, les novations ne sont pas déterminantes et de ce fait réversibles. Au même titre, le débat a été longtemps de savoir si la « révolution » devait être mondiale ou pouvait être localisée.
Je sais, la simplification conduit souvent à la caricature mais on me reproche le travers d’être trop long. Eh ! Je fais ce que je peux ! Au demeurant, j’ai tenté de vous brosser un tableau presque compréhensible des mouvances du socialisme pendant un siècle.
Quoi qu’il en soit, bien que ces socialistes se divisent entre révolutionnaires et réformistes, les pouvoirs en place ne s’y sont pas trompés et ont toujours cherché à regrouper, dans une union sacrée les forces non socialistes. C’était pour eux une question de survie.
En résumé, on peut constater que les socialismes ont en commun, outre une vision internationaliste de l’humanité, le rejet d’une injustice sociale et, partant de là, une volonté délibérée d’y remédier en modifiant, de façon réformiste ou révolutionnaire, les règles du jeu de l’organisation de la société humaine. Ils sont divisés en diverses chapelles. Deux se distinguent particulièrement. D’une part les anarchistes qui, par essence, du fait qu’ils placent le combat essentiellement sur le plan économique et refusent l’organisation politique, se trouvent en contradiction avec eux même et de ce fait se marginalisent plus ou moins volontairement et, d’autre part, les communistes qui sont largement le moteurs volontaire ou involontaire dans les fluctuations théoriques de toute la mouvance.

Après tous ces prolégomènes, nous allons, enfin, pouvoir mieux comprendre comment j’analyse ce qu’on appelle, en France, aujourd’hui, le Parti Socialiste.
LES PARTIS
Petit tour d’horizon de l’existant.
LE PARTI SOCIALISTE
La SFIO (première partie)
Comme vous êtes des esprits fins et pertinents, vous vous doutez que ce qu’on appelle aujourd’hui le parti socialiste en France est la résultante œcuménique de cette nébuleuse du dix neuvième siècle. C’est là que vous vous trompez.
En fait, le parti socialiste est né en 1969 en deux temps. Il est le résultat de l’échec socialiste aux élections présidentielles du printemps 69 (Gaston Deferre reçoit environ cinq pour cent des suffrages et Monsieur Michel Rocard trois virgule six). Les différentes chapelles socialistes se regroupent dans une instance unique, le PS est né. Cependant, la formation largement majoritaire est l’ex SFIO (section française de l’internationale ouvrière). Il est à noter que cette SFIO se réclame de la première internationale (ouvrière) et non de la deuxième (socialiste). Quoi qu’il en soit, on sait les entre déchirement internes que ces deux organisations ont traversé.

Puisque SFIO il y a, voyons un peu le parcours de celle-ci.
Vers 1870, la France est encore (contrairement à l’Allemagne et l’Angleterre) un pays essentiellement rural. Les mouvements socialistes sont présents presque exclusivement dans les grandes villes.
La répression qui s’abat suite aux évènements de la Commune de Paris en 1871 va décapiter de façon sanglante les
mouvements ouvriers et socialistes.

On compte entre vingt et trente mille morts, plus de trente cinq mille arrestations et déportations
(dont Louise Michel en nouvelle Calédonie) et autant de fugitifs et exilés. Après cette élimination physique d’environ cent mille personnes engagées dans la lutte politique, les partis
conservateurs au pouvoir peuvent espérer en être débarrassés pour longtemps.

Il n’en est rien. Dès 1872 des exilés se réorganisent. En 1878 une fédération unitaire des socialistes voit le jour, mais des dissensions internes la font voler en cinq composantes en 1882. Ce que ces factions ont de curieux, c’est qu’elles s’entrecroisent tant entre elles qu’à l’intérieur d’elles mêmes. Les voici.
Les possibilistes veulent fractionner le but final en plusieurs étapes pour le rendre « possible ». Ceci est une vision Marxiste. Mais l’aile ouvrière va suivre Jean Allemane et les possibilistes ne regroupant plus que des artisans et professions libérales, ne seront plus qu’un parti républicain
Les Allemanistes se séparant des possibilistes sont plus proches de l’anarchisme. Ils prônent des réformes plus immédiates et globales dans une action plus syndicale et économique que politique. Ils souhaitent une décentralisation et imaginent une gestion des entreprises par les travailleurs.

Les socialistes indépendants. Au départ c'est un regroupement de plusieurs personnalités radicales et républicaines. Ce sont des hommes comme Jean Jaurès ou Alexandre Millerand, qui deviennent très rapidement députés. Ils dominent par leur qualité oratoire les divers groupes ouvriers ou socialistes qui constituent le parlement. Ils se regroupent autour des idées de solidarité républicaine mais ne s'occupent pas de la rupture entre les socialistes et la république bourgeoise. En 1902 leur fusion avec les possibilistes crée le Parti socialiste français.

Les guesdistes : le Parti ouvrier français, créé en 1880 en tant que Parti ouvrier, par Jules Guesde et Paul Lafargue. C'est une organisation qui se bat non seulement pour des réformes mais aussi pour la conquête du pouvoir politique par les prolétaires. C'est une organisation marxiste, qui est en lien avec Karl Marx et Friedrich Engels. C’est numériquement le parti socialiste le plus important en France.
Le Parti socialiste révolutionnaire (PSR) blanquiste. Le PSR a été renforcé en 1896 par la scission d'élus et responsables régionaux exclus des Allemanistes regroupés en 1897 sous le nom Alliance communiste révolutionnaire (ACR). Le PSR est dirigé par Édouard Vaillant, qui fait parti de l'union des indépendants et des marxistes.
Je vous avais prévenus, hein, vous voyez, tout cela s’entrecroise de façon assez confuse.
En 1901, deux mouvements socialistes s'opposent:
* une « gauche », clairement révolutionnaire, avec Edouard Vaillant et Jules Guesde ;
* une « droite », plutôt réformiste, avec Jean Jaurès et Paul Brousse.
Ces courants s'opposent régulièrement, par exemple lorsque Millerand accepte d'entrer au gouvernement bourgeois, Guesde et Vaillant dénoncent cette prise de position en déclarant que cela discrédite le socialisme. Malgré ces rivalités, Vaillant prône l'unification.
Deux rassemblements se développent :
Parti socialiste français : en gros, les réformistes. Ce parti est dirigé en 1902 par Jaurès.
Parti socialiste de France : il regroupe en gros les révolutionnaires. Ce parti a comme figure de proue Jules Guesde. Les guesdistes fournissent les 5/6 des effectifs. Créé en 1901 sous le nom d’Unité socialiste révolutionnaire.
Pourtant, ces deux groupes vont se réunir.
L'unification du socialisme français a lieu en 1905. Le parti socialiste, section de l'Internationale ouvrière, plus connu sous le sigle SFIO, parti du mouvement ouvrier, est né.
Ce rassemblement est à la fois une victoire des révolutionnaires et une victoire des jauressiens. En effet, ceux-ci représentent le tiers de la direction.
La SFIO prend position contre la politique coloniale et le nationalisme belliciste. Cependant il y a encore des divergences sur les questions d'actualités. La rupture entre Vaillant et Guesde intervient dès 1906, sur l'indépendance syndicale. Mais c'est sur la question de la guerre que la rupture intervient nettement. Jaurès, suivant la doctrine de l'Internationale, en appelle à la grève générale, voire à l'insurrection, afin de prévenir ou d'arrêter le conflit. Jules Guesde pense lui que la guerre peut détruire le capitalisme, et redoute que la grève ne devienne effective et affaiblisse les pays les plus industrialisés, ceux où l'organisation ouvrière serait plus forte. C'est une des raisons pour lesquels les idées de Jules Guesde sont de moins en moins approuvées par les adhérents SFIO qui se rangent du coté de Jaurès.
Le 28 juillet 1914, la SFIO publie un manifeste disant "A bas la guerre, vive la république sociale, vive le socialisme international". Ce manifeste montre que les socialistes à ce moment étaient fermement contre la guerre. Trois jours plus tard, Jaurès est assassiné par un nationaliste. Dès le 2 août, il y a un basculement total avec le discours de Vaillant qui déclare "en présence de l'agression, les socialistes accompliront tous leur devoir pour la patrie". Le 4 août, les socialistes votent les crédits de guerre, et le 26 août lors de la création du gouvernement les blanquistes et les guesdistes sont représentés dans le gouvernement de l'union sacrée.
Ainsi, en 1914 la grande majorité de la SFIO accepte de cautionner la guerre, contrairement à tous ses engagements antérieurs.
Après la guerre, le mouvement ouvrier se développe et la SFIO aborde les élections législatives avec sérénité mais elle présente un nouveau programme nettement réformiste rédigé par Léon Blum qui rejette nettement la perspective révolutionnaire en déclarant que celle ci « se présentera à son heure historique ». Deux franges s'affrontent : les révolutionnaires et la SFIO réformiste. Des grèves éclatent dans de nombreux secteurs, cependant, la SFIO refuse de déclarer la grève générale. En février 1920, au congrès de Strasbourg, les adhérents acceptent à 92% le retrait de la SFIO de la Deuxième Internationale, discréditée par son attitude favorable à la guerre.
En 1920, au Congrès de Tours, la question de l'adhésion à l’Internationale communiste divise la SFIO.
À gauche, les partisans de l'adhésion sont d’une part les membres du Comité de la troisième Internationale d’autre part des anciens des courants socialistes de droite ou du centre ralliés à cette position.
Au centre, il reste l'ancienne tendance de gauche guesdistes qui serait pour l’adhésion mais sous certaines réserves. Ils contestent l’aspect dirigeant de la IIIème internationale (c'est à dire qu'ils ne sont plus libres de leur politique propre) et le dogme de l’insurrection (révolution «blanquiste» des bolcheviks). »
Enfin la droite des « reconstructeurs » (partisans de Léon Blum), qui s'opposent catégoriquement à l'adhésion.
Malgré ces oppositions, l'adhésion à la IIIe Internationale ouvrière se fait par les trois quarts des voix. La SFIO se divise en deux, les majoritaires créent un nouveau parti : la SFIC (Section française de l’Internationale communiste) que l'on appellera plus tard le Parti communiste, puis PCF.
Nous regarderons plus tard l’évolution du PCF mais, de son coté, la nouvelle SFIO n'est pas un parti important du point de vue de ses adhérents. Cependant, elle a un réel poids électoral. La SFIO adhère à la nouvelle Internationale ouvrière socialiste.
Suite à ces évènements, la SFIO, ayant perdu tous ses éléments les plus combatifs et les plus révolutionnaires, ne fait plus bien la nuance entre participer au gouvernement et modifier la société. Elle a oublié la « sociale » et se contente de gérer l’existant.
LES PARTIS
Petit tour d’horizon de l’existant.
LE PARTI SOCIALISTE
La SFIO (deuxième partie)
A partir de la scission de 1920, on peut considérer que la SFIO se trompe d’adversaire. En effet, on a vu que la SFIO est une minorité réformiste qui refuse de se plier à une majorité plus révolutionnaire (avec toutes les restrictions que l’on peut y adjoindre) des communistes.

Elle va dépenser une énergie importante pour lutter contre cette majorité honnie et, en même temps, s’allier avec des partis plus à sa droite dans l’intention d’entrer au gouvernement avec des intentions louables au départ, mais stériles dans la pratique. En même temps, elle va être déchirée par des tendances sur sa gauche qui régulièrement seront exclues.
Le paysage des années 1930 est marqué par la montée du fascisme. Ce qui précipite le déclenchement en France d’une lutte intense contre celui-ci, c'est l'évènement du 6 février 1934 où plusieurs ligues d'extrême droite essaient de rentrer dans le palais bourbon. La gauche voit en cette journée une tentative de renversement de la république. C'est pour cela que dans un premier temps, la gauche organise une contre manifestation le 8 février 1934. A partir de ce moment-là, les divers courants de gauche vont s’unir.

Après le rapprochement dans la rue, il va y avoir une alliance entre les partis : dès juillet 1934 la SFIO et le parti communiste mettent de coté leurs querelles pour gagner les élections de 1936. Le 14 juillet 1935, les radicaux signent le ralliement populaire, ceci est célébré comme un événement national.
En janvier 1936, les différents partis se mettent d'accord sur le programme "pain, paix, liberté". Ce
programme de Front Populaire va permettre de gagner les élections de 1936. La victoire électorale est accueillie durant les mois de mai et juin par de grandes grèves spontanées, avec plus de 2
millions de grévistes. C'est une grève de pression politique, avec des occupations d'usines.

salariés veulent voir concrétiser dans la pratique ce qu’ils ont gagné dans les urnes.
Sous la pression des grèves, le Front Populaire va procéder à plusieurs réformes en faveur des travailleurs comme la semaine des 40 heures, l’instauration de deux semaines de congés payés, et une augmentation des salaires de 7 à 15%. Cependant, la situation économique reste mauvaise, la production baisse. Dès septembre, la hausse des prix est supérieur à la hausse des salaires, Léon Blum (Président du conseil socialiste) est obligé de dévaluer le Franc et en même temps, il décide de faire une pause dans les réformes. En faisant cette pause, il perd la confiance des socialistes et des ouvriers.

La deuxième cause de son renversement est que le Front Populaire refuse d’intervenir pour aider militairement la République espagnole, qui est confrontée au coup d’Etat franquiste. Blum décide de ne pas s'engager dans cette guerre malgré lui. Daladier va aussi critiquer le gouvernement alors qu'il en fait lui-même partie. Le parti radical refuse les pleins pouvoirs à Léon Blum en juin 1937. C'est la fin du Front Populaire.
La Seconde Guerre mondiale allait diviser en deux la SFIO : ceux qui sont favorables au gouvernement de Vichy généralement par un «pacifisme» extrême, et les autres, majoritaires, qui rejoignent les rangs de la Résistance.
Une partie (partisans de Paul Faure) choisit la retraite et le silence. Mais il y a une autre partie, une minorité qui participe à la presse "collaborationniste" et s'engage dans des organisations d'extrême droite dont le rassemblement populaire de Marcel Déat. Cependant, il y a peu de militants qui adhèrent à ce mouvement. Pendant tout le début de la période de l’occupation, les militants moyens ne font rien. Le réseau est affaiblit depuis août 1940, les conseils généraux sont suspendus et les conseils municipaux sont nommés par Vichy.
A partir d’août 1940, apparaissent les premières tentatives de construire un parti clandestin prêt à l'action contre l'occupant : le Comité d'action socialiste (CAS), qui compte 2 000 adhérents. Le CAS se renforce au cours de l'année 1942, et devient la SFIO reconstituée en mars-juin 1943.
Certains, comme André Philip, rejoignent la France libre à Londres.
Le parti socialiste appelle les socialistes à rejoindre les mouvements de résistance existants, au nom de l'union nationale. Lorsque le Conseil national de la Résistance (CNR) est créé en 1943, la SFIO y est représentée en tant que telle.
La SFIO se reconstitue à la Libération. La dérive de certains collaborateurs est allée, pour certains, jusqu'au fascisme.
En 1945 la SFIO compte 336 000 adhérents, ce qui est inférieur au PCF qui compte dans ses rangs 791 373 adhérents.
Je vous passe les détails entre 1945 et 1947 sinon, je vais encore me faire dire par certains que je suis trop long. Toujours est-il qu’aux élections de 1947, elle a perdu du terrain derrière le PCF (17% contre 28%). Cependant, Vincent Auriol, socialiste, est élu premier président de la quatrième république.
En 1946, Guy Mollet devient secrétaire général de la SFIO et ce jusqu’en 1969, année de sa
dissolution. Entrés dans l’opposition en 1950, les socialistes reviennent au pouvoir en 1956 avec le gouvernement Guy Mollet.

L’affaire du canal de Suez, la politique algérienne de Guy Mollet (poursuite de la guerre), le soutien à Charles de Gaulle en 1958, firent apparaître de nouvelles divisions et scissions : le Parti socialiste autonome (PSA) en 1958, puis le Parti socialiste unifié (PSU) en 1960.
En 1962, la SFIO a perdu 80 % de ses adhérents par rapport à la Libération, et la moitié de son électorat. La SFIO n'arrive plus à recruter dans les métiers techniques. Sa politique sur l'Algérie est largement désavouée par le reste de la Gauche, et par de larges couches de la jeunesse. À tous points de vue, la SFIO de Guy Mollet n'est plus qu'un squelette de la SFIO d'antan.
En 1964, il y a 2 tendances, ceux qui veulent battre De Gaulle par le cadre institutionnel, et ceux qui veulent transformer la gauche non communiste en force d'appoint. Les syndicats refusent de participer au soutien de cette disposition, et le PSU fait de même.
François Mitterrand, homme politique de centre-gauche qui n’appartient pas à la SFIO, a une conception différente. Il voit la nouvelle politique française en un affrontement bipolaire : une union de toute la gauche contre la droite gaulliste. C'est pour cela qu'il se présente pour les élections de 1965 comme candidat unique de la Gauche. La campagne est un franc succès : face à de Gaulle il obtient au premier tour 32,2 % des voix, et au second tour 45 %. Mitterrand fonde dans la foulée la Fédération de la gauche démocrate et socialiste (FGDS) qui regroupe la SFIO, le parti radical, la Convention des institutions républicaines et divers clubs. C’est à dire la gauche non communiste.
En 1969, tous les alliés envisagés se dérobent et se présentent séparément. La SFIO se présente seule aux élections et ne recueille que 5 % des voix (candidature Defferre). Ces élections seront les dernières auxquelles se présente un parti sous l'appellation SFIO.
En 1969, la SFIO fusionne avec l'Union des clubs pour le renouveau de la gauche pour créer le Parti socialiste, lors du congrès d'Issy-les-Moulineaux.
En résumé, on constate que la SFIO, à partir de la scission de 1920 où elle est très largement minoritaire de droite, a dépensé une quantité d’énergie considérable à lutter contre les positions plus radicales du reste des socialistes. A de multiples reprises, elle a exclu de son sein les tendances les plus avancées de sa mouvance et, dans le désir permanent de participer à des gouvernements, n’a jamais hésité à s’allier avec des partis plus à droite non socialistes. Au nom d’un humanisme vague, sans théorie précise, elle a renié ses origines, se contentant de gérer et d’administrer « l’état bourgeois ». A sa disparition, en 1969, il y a longtemps que la SFIO ne crie plus : « A la sociale » !

Voilà, Braves Gens !
Maintenant, il va être facile de vous présenter le Parti socialiste comme je le vois.
LES PARTIS
Petit tour d’horizon de l’existant.
LE PARTI SOCIALISTE
Pendant que j’y pense, j’aimerais attirer votre attention sur une singularité qui m’amuse.
Je ne sais pas si vous avez remarqué tous ces gens qui, bon chic, bon genre, situation sociale bien établie et train de vie satisfaisant vous affirment sans rire, et même avec une certaine flamme : « Mais moi, vous savez, je suis de gôche ! » En soi, cela n’a rien de contradictoire. On sait que les phares de la pensée d’autrefois étaient, pour la plupart, issus de la bonne bourgeoisie voire de la noblesse moyenne. En revanche, on sait aussi que cela ne les a pas enrichi et souvent, que cela a entraîné dans leur histoire personnelle quelques désagréments.
Voilà donc des gens, qui, affichant une réussite sociale évidente ou une appartenance à la petite ou moyenne bourgeoisie ou, cadres moyens ou supérieurs, se proclament de « gôche » et vont parfois (oh, comble de la témérité) jusqu’à affirmer être socialiste. Je le redis, cela n’a, en soi, rien de surprenant. Où cela devient plus inattendu, c’est quand ils se mettent à parler de leurs prises de position. Au nom d’un socialisme « moderne », ils récusent toute opposition idéologique, ils stigmatisent les syndicats, ils confirment, avec un sourire entendu, la disparition de tout antagonisme de classe et méprisent prodigieusement le petit peuple. Ajoutez à cela une petite touche xénophobe et raciste et un rien de soumission religieuse… Ah bon ? Et où sont-ils, alors, là dedans, leur esprit de gauche et leur socialisme ? Et la « sociale », là dedans, qu’est-ce qu’elle devient ?
Vous ne trouvez pas tout ça un peu paradoxal, vous ? Parce qu’ils ont le droit d’être conservateurs, mais alors, qu’ils le disent. Non, on dirait qu’ils ont honte. Ou plus exactement, on dirait que contre toute nature ils veulent se présenter comme une chose qu’ils ne sont pas.
Pourquoi ? Oui, pourquoi ?
Je ne voudrais, bien sûr, pas vous influencer de façon insidieuse, mais j’ai une petite idée. Et comme je suis, vous l’avez remarqué, particulièrement retors, je vais vous l’exposer brièvement.
Non, ne riez pas niaisement, j’ai dit brièvement.

A travers les âges, et plus particulièrement depuis quelques siècles, les grands novateurs, les grands précurseurs, les grands humanistes, étaient des progressistes et plus tard, des socialistes. Ils se caractérisaient par un esprit libre, un affranchissement des idées reçues et une indépendance de pensée qui, a posteriori, ont fait d’eux, dans notre souvenir, des personnages héroïques qui ne sont pas dépourvus d’un romantisme exaltant. Alors, pour se donner ce même romantisme, pour se parer de cette générosité, de cette même grandeur, on préfère se draper dans cette image conquérante d’opiniâtre noblesse.
De là à, effectivement, s’engager dans une lutte difficile, douloureuse, voire dangereuse, il y a une nuance. Eh ! On ne va quand même pas hypothéquer sont petit bien être (même médiocre) personnel.
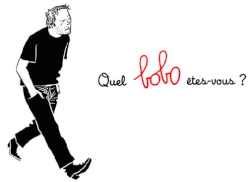
Alors, trouver un parti qui est officiellement de gauche et qui, de surcroît, s’auto proclame socialiste mais qui au demeurant se garde bien de changer quoi que ce soit à la société, s’en faire un zélateur et un prosélyte passionné, vous ne trouvez pas ça narcissiquement valorisant ? Se présenter comme un héros chevaleresque des temps modernes sans en encourir les risques, se déplacer dans une aura de bienfaiteur officiel de l’humanité en occultant soigneusement les injustices, se perdre dans des discours flous sur les misères et les douleurs de la planète en évitant aussi soigneusement d’y remédier, vous ne trouvez pas ça égocentriquement confortable, vous ?

Cela me rappelle aussi une autre chose, vous savez, ces petits bourgeois qui, autrefois, allaient s’encanailler dans des gargotes louches pour jouer au peuple… Aujourd’hui, on pourrait les rapprocher des « bourgeois bohème » que l’on raccourcit en « bobo » et, pour ceux qui sont plus fortunés, des « gauche caviar ».
Bon ! Et si nous revenions au Parti socialiste ?
Comme nous l’avons dit, en 1969, la SFIO était moribonde. François Mitterrand, qui n’était pas un socialiste, aventurier remarquable, imagine de la « relooker » et d’en faire un outil au profit de sa carrière personnelle.
Comme il souhaitait une politique française gérée par un bipartisme à l’américaine, c’est à dire vidé
de sa conscience de classes et de tout esprit de « la sociale », il a l’intelligence d’utiliser cette manne électorale à son profit.

Il se trouve qu’à ce moment, les volontés hégémoniques du Général De Gaulle divisent la France en deux, Mitterrand a la pertinence de se présenter comme la valeur unique anti-gaulliste. Il ne faut voir là dedans aucune intention idéologique. C’est juste, comme je l’avais décrit précédemment, je veux être khalife à la place du khalife. Si l’on considère, de plus, que, dans le passé, son anti-gaullisme l’avait déjà, certes pendant un temps bref, conduit à opter pour le gouvernement de Vichy du Maréchal Pétain, on comprend que cette opposition de personne n’était pas liée à une vision spécifiquement révolutionnaire, pas plus socialiste et même pas de gauche. Il a, du reste, déclaré lors d’un congrès de l’internationale socialiste ouvrière à Vienne (en Autriche) que son projet était de ramener le parti communiste à un rôle marginal. Il faut lui reconnaître qu’il y a parfaitement réussi.
Dans un premier temps, il regroupe toute la gauche non communiste et, de ce fait, racolant une partie de la démocratie chrétienne à l’esprit plus jaune que rouge bien connu, parvient à se donner une image de sauveur du peuple. Il réussira cette performance d’être désigné premier secrétaire du nouveau parti « socialiste » alors qu’il n’a jamais fait parti d’aucune de ses composantes. Un peu plus tard, en 1981, il sera élu à la présidence de la république au nom d’un programme commun de la gauche qu’en gros, il refusera toujours de signer.
A partir de 1981, nous voici donc dans une situation de gouvernement socialiste. Le soir du dix mai, les gens dansaient dans les rues et pleuraient d’allégresse et d’espoir. Ils y ont cru ! Ils y ont cru ! Ils y ont même tellement cru que dans les jours qui suivirent, des conservateurs, qui se croyaient un peu nantis, morts de peur, ont réalisé leur patrimoine et, craignant de voir défiler des chars soviétiques sur les champs Elysée, sont allés placer leur petit magot en Suisse.
Quand on demande à des socialistes le bilan de leurs divers gouvernements, ils vous lancent péremptoirement au visage trois choses : L’abolition de la peine de mort, l’augmentation de quelques revenus comme le minimum vieillesse et la diminution du temps de travail.
Tu parles !
La peine de mort ? La France a été le dernier pays européen à s’en soucier. Même si la Suisse et la Grande Bretagne la conservaient dans leurs textes, elle n’y était plus appliquée. On peut considérer que c’était une décision inéluctable. Elle aurait eu lieu quel que soit le gouvernement. Ce n’était qu’une question de temps. On sait, du reste, que certains rêvant de la rétablir se sont heurtés, plus tard, à Monsieur Jacques Chirac qui était fermement abolitionniste. Et puis, je ne voudrais faire de la peine à personne, mais, peine de mort ou pas peine de mort, quelqu’un pourrait-il me dire ce que ça change dans les rapports économiques et l’injustice sociale ? L’abolition de la peine de mort, cela n’a rien coûté aux grands capitalistes et n’a rien apporté aux fin des mois des salariés.
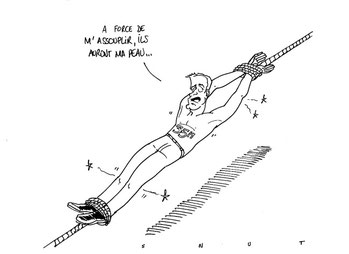
Les maigres augmentations salariales, comme aucunes disposition de contrôle de l’inflation n’a été organisée simultanément, il a suffit de quelques mois, voire quelques semaines pour que les choses soient ramenées à la situation antérieure. C’étaient des mesures quantitatives et non qualitatives qui, dans le fond, tenaient surtout à une propagande momentanée.
Quand à la diminution du temps de travail, cela a été bâtit avec tellement de frilosité, de réticences, de minorations et avec tellement de mauvaise volonté qu’aujourd’hui encore, non seulement ce n’est pas acquis mais, c’est remis en question. Comme précédemment, cela n’a pas été pensé comme une transformation qualitative et irréversible, mais, quantitativement, comme un os qu’on donne à ronger aux gens de l’extrême gauche qui commençaient à avoir une audience trop importante dans la population.
Après Mitterrand, que reste-t-il du parti socialiste ?
Statutairement, le parti socialiste est constitué de tendances, (résidu du fait qu’il était à l’origine une coalition disparate). Ces courants, eux mêmes partagés en subdivisions plus inextricables sont devenus les vassaux de quelques chantres qui utilisent ces factions pour leur avancement personnel. C’est un champ clos de luttes fratricides de personnes et en aucun cas, on ne voit des positions théoriques ou idéologiques les sous-tendre.
Le bipartisme, cher à François Mitterrand, a conduit le Parti Socialiste à se croire l’opposition de droit divin. Quand Monsieur Jospin le 21 avril 2002 reçoit la gifle électorale que l’on sait, lui et le Parti Socialiste ne comprennent pas et considèrent que c’est le peuple de France qui a été mauvais et non pas eux qui ont été décevants. Ceci me rappelle une boutade de Berthold Brecht dont le PS est, en l’occurrence, un exemple parfait. « Quand il y a désaccord entre le peuple et le gouvernement, il faut changer de peuple ».
Suite à cette situation, divers chantres du PS se sont chamaillés et continuent de le faire pour mettre la main sur la machine électorale. Cela a conduit Madame Royal, malgré (et sans doute à cause) des discours creux et d’un vide socio-idéologique navrant à un nouvel échec. Elle et ses concurrents au sein du parti avaient espéré rééditer la manœuvre de Mitterrand en quatre vingt un. Elle avait juste négligé, dans son arrivisme individuel, que la situation n’était pas la même et que Mitterrand, lui, au moins, dans son carriérisme exacerbé, était intelligent.
Un nouveau congrès du parti se prépare et j’ai entendu deux remarques qui ont attiré mon oreille. Dans l’une des motions, on demande d’épurer le parti de toutes ses références marxistes… Ah bon ? Je croyais que c’était fait depuis mille neuf cent vingt. Un autre protagoniste demande de changer le nom du parti en en retirant le mot socialiste. La boucle est bouclée. Personnellement, je pense que ce serait bien parce que logique. Je pense qu’ils ne le feront pas. Il y a, à la base des gens qui se sentent socialistes et qui jusque là, refusent d’admettre qu’ils ont été trompés. Comme le Parti Socialiste est essentiellement une machine électorale, il ne peut pas se permettre de s’aliéner une partie de son électorat même si par ailleurs il a du mal à la contrôler.
Le Parti Socialiste s’est vidé de son rôle idéologique et n’a plus rien à proposer à la population. Il est devenu une opposition de clan et ne représente plus rien sur le plan théorique.
Avant d’en finir, j’aimerais vous livrer, avec tristesse, une proposition qui ne m’est que strictement personnelle mais qui m’est chère.
Le Parti Socialiste, et sous les différentes appellations qui l’ont précédé, à force de lutter véhémentement contre les tendances les plus avancées et le plus combatives des idées socialistes ne s’est-il pas détruit lui même ? Combattre les espérances lumineuses de certains en annihilant toute volonté de justice sociale, n’était-ce pas une activité suicidaire ?
En conclusion et pour utiliser une métaphore, je me demanderai : Les socialistes n’ont-ils pas la pertinence de comprendre que dans une voiture, quand on retire le moteur, il devient très difficile de la faire avancer ?

Et du coup très difficile de lui trouver un acquéreur.
LES PARTIS
Petit tour d’horizon de l’existant.
Le Parti Communiste
Nous avons déjà assez longuement évoqué les communistes dans l’article consacré aux socialismes. En effet, nous avons vu que les communistes sont une famille parmi les socialismes. Cette famille a été longtemps le groupe largement majoritaire et à travers les temps, ce qui a différencié les communistes de la plupart des autres groupes, est leur position nettement révolutionnaire. De ce fait, leur rôle moteur est considérable.

Nous devons désormais les observer non plus en tant que socialistes, mais selon leurs qualités et leur histoire propres.
On pourrait penser, bien sûr qu’il suffit, à ce titre, de reprendre le parcours des communistes à partir de la scission de 1920 et de parcourir avec eux le dernier siècle.

Ce n’est pas si simple que ça.
Et là, les gens pressés d’arriver au bout commencent à maugréer.
Toutefois, vous m’accorderez qu’il est difficile de parler des communistes sans parler du marxisme.
Oh ! Rassurez-vous, je ne vais pas vous en faire une description exhaustive ; d’abord parce que ce n’est pas le lieu et que je manquerais de place et, ensuite, parce que j’en suis
fichtrement incapable.

Des gens très bien l’ont fait et je vous invite à consulter les innombrables travaux de non moins innombrables auteurs.
En second lieu, vous comprendrez que parler du Parti Communiste sans faire un petit détour par ce que fut l’Union Soviétique serait une vue bien parcellaire des choses.

Ce n’est qu’après ces préalables que nous pourrons mieux aborder l’étude du Parti Communiste Français.
Il est toutefois évident de constater, sans autres précautions que ce parti semble, aujourd’hui, quasi agonisant, voire moribond.
LES PARTIS
Petit tour d’horizon de l’existant.
Le Parti Communiste
Voyons donc le marxisme.
Il va de soi que Karl Marx (1818 1883) n’a pas inventé le communisme, pas plus le parti, ni même le mot.
La notion de communisme vient de l’idée de mise en commun, de communautarisme, de vie communautaire. Ce qui caractérise les animaux
sociaux, c’est précisément ce système de mise en commun des capacités de chaque individu. Nombre de prédateurs chassent en commun puis, partagent leur proie dans une curée commune (ce qui ne va
pas sans chamailleries). C’est un comportement normal de certains animaux dont l’animal humain. Les chasseurs cueilleurs du paléolithique cueillent, pèchent ou chassent en commun. Longtemps après
les débuts de la civilisation, de nombreuses activités agricoles sont effectuées en commun. Pendant le moyen âge, que sont les monastères si ce n’est une vie communautaire ? De nos jours,
encore, il n’est pas rare que Jojo et Bébert achètent une tondeuse à gazon en commun. C’est encore une forme de communautarisme. C’est ce que Marx (et d’autres) appellent le communisme
primitif.

Dans ce communisme primitif, chacun apporte au groupe ce dont il est capable et voit ses besoins assumés par le groupe. C’est ce que Marx traduira par l’expression « de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins ».
A travers les siècles, des théoriciens ont imaginé des modes de vie inspirés de cette pratique
naturelle. Thomas Moore, déjà cité, imagine une île fonctionnant sur ce mode. Cette île ; il lui invente un nom : Utopie. Vous voyez que le nom a eu un certain
succès.

Plus tard, Fourier (François Marie Charles 1772 1837) veut créer des phalanstères (lieu de vie pour une phalange d’individus) qui ne sont pas plus que des monastères laïcs.
Les intentions actuelles de cogestion ou d’autogestion d’entreprises qui sont plutôt une résultante de la pensée anarchiste sont aussi des façons de voire communautaristes donc communistes.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pour le moment, je ne vois rien, là dedans, de monstrueusement inhumain.
Donc, je réitère : Marx n’a rien inventé.
Si, un peu, quand même. Disons qu’il a tenté de bâtir un ensemble cohérent de toutes ces intentions plus féeriquement merveilleuses et sentimentales que réalistes.
Avant Marx, les théories socialistes, comme nous l’avons déjà vu, ont été nombreuses et variées.
Nous sommes au milieu du dix neuvième siècle. La technologie et la science progressent à une vitesse
jusque là inimaginées.

Charles Darwin (1809 1882) émet ses hypothèses (qui ne seront pleinement acceptées que vers 1930) sur l’évolution des espèces.
Karl Heinrich Marx, qui est avant tout un philosophe, veut bâtir une théorie socialiste nouvelle. Pas une de plus ! Non. Une définitive. Il rejette les travaux de certains de ses prédécesseurs qu’il qualifie de critico-utopistes (en référence à Thomas Moore). Il déclare ne pas être là pour décrire la société mais pour la modifier. Nous sommes au siècle de la science. Les autres étaient des socialistes utopiques, son socialisme sera le socialisme scientifique.
Pour ce faire, il applique, à son étude de la société, une méthode qu’on appellera après sa mort une dialectique matérialiste.
Le matérialisme, je vous en ai déjà parlé ; mais je pense qu’il n’est pas inutile de vous rafraîchir la mémoire. Mais quand prendrez-vous donc des notes ? Le matérialisme consiste à considérer, contrairement à l’idéalisme qui dit le contraire, que la matière prime sur l’idée et lui est nécessairement antérieure. En caricaturant à peine : je vois la petite cuiller parce qu’elle existe et non pas elle existe parce que je la vois.
Eh, je ne vais pas toujours vous tenir la main pour traverser la rue, quand même !
Bon, ça y est ? C’est rentré le matérialisme ?
Alors passons à la dialectique.
La dialectique c’est une chose qui est vieille comme le… J’allais écrire comme le monde. Non, n’exagérons pas. Disons seulement: comme la réflexion philosophique. Constatons cependant que la dialectique a eu au travers des siècles et des millénaires des significations Légèrement différentes.
A l’origine, le mot est de la même racine que dialogue et s’oppose dans l’exposé des pensées à la notion de rhétorique qui elle implique le discours. Par la dialectique, l’auteur, grâce à ce procédé, peut à tout moment placer dans la bouche des deux protagonistes des avis contraires et contradictoires.
Traditionnellement, on prête les premières manifestations de ce mode d’exposé à Parménide (philosophe pré socratique dont on connaît mal les dates de naissance et de mort. Il semblerait, toutefois que Parménide soit arrivé à Athènes vers l’âge de soixante cinq ans et qu’il y ait rencontré le jeune Socrate alors âgé d’environ vingt ans. Si cela est juste, Parménide serait né vers cinq cent dix avant Jésus christ).
Quoi qu’il en soit, si l’on en croit Platon, la dialectique était l’arme redoutable de Socrate. Celui-ci, par un jeu subtil de questions poussait son contradicteur à donner d’abord, vu que la conversation était publique, une réponse « politiquement correcte » puis à se contredire afin de le conduire à une solution plus juste. Socrate, dont la mère avait été sage femme appelait cela l’accouchement des âmes ; expression que l’on traduira plus tard par « maïeutique ».
On sait que Platon, lui-même, a largement usé de la technique des dialogues. Plus tard, Aristote écrira aussi des textes théoriques sur la prééminence de la dialectique (s’il n’y a plus de contradiction, c’est qu’on est arrivé à une vérité).

Pendant tout le moyen âge, le christianisme enseigna la dialectique parallèlement à la rhétorique. Je vous remémore juste les joutes oratoires organisées dans les universités où deux protagonistes devaient faire assaut d’intelligence pour débattre, l’un pour et l’autre contre sur un sujet parfaitement stérile parfois. Rabelais en donne même une caricature dans les chapitres XVIII, XIX et XX de Pantagruel : « Comment Panurge feist quinault (ridiculisa) l’Angloys qui argoit (argumentait) par signes ». Je vous le recommande. Thaumaste (l’anglais) veut visiblement évoquer la Sainte Trinité et Panurge ne lui répond que par des signes franchement scato-pornographiques.
Par la suite, et, sans doute, lié assez largement à l’école des jésuites au dix-septième siècle, la dialectique, avec la présence constante de l’argument et du contre argument, assimilée au syllogisme qui lui aussi pose un contre argument mais se déroule en trois temps (argument majeur, argument mineur et conclusion), débouchera sur le plan sacro-saint de thèse, antithèse, synthèse de la non moins sacro-sainte dissertation.
Alors, vous voyez, hein, la dialectique, ce n’est pas du pipi de chat !

Les choses changent un peu avec Hegel.
Hegel (Georg Wilhelm Friedrich 1770 1831) est un philosophe allemand. Son œuvre est l'une des plus représentatives de l'idéalisme allemand et a eu une influence décisive sur Marx. Il est célèbre pour son analyse de la « dialectique du Maître et de l'esclave », ainsi que pour la « Phénoménologie de l'esprit ».
Et si on faisait un peu de logique ?
Prêts ?
Alors, on y va.
La logique classique pose comme première loi de la pensée qu'on ne doit pas se contredire. Il s'agit alors d'une pensée linéaire. La pensée n'est pas contradictoire car elle serait alors erronée. Au contraire, pour Hegel, la pensée ne progresse que par la dialectique, par la synthèse d'idées qui s'opposent.
La dialectique est habituellement identifiée au syllogisme et ses trois moments : thèse, antithèse, synthèse ou position, opposition, composition. Cependant, Hegel montre que le moment négatif se divise en deux : opposition extérieure et division intérieure ou médiatisé et médiatisant. Cela n'empêche pas la pertinence de la division ternaire, omniprésente.
La dialectique n’est pas une méthode extérieure imposant une forme immuable comme la triplicité, c'est le développement de la réalité, de la chose elle-même. Pour Hegel, il s’agit en fait de dégager ce qu’il y a d’intelligible dans la réalité, et non d’en produire une nouvelle interprétation. La philosophie décrit la réalité et la reflète.
Il est d'accord avec Descartes pour soutenir que "être c'est penser": mais penser c'est connaître le monde qui est devant soi. C'est donc exister d'abord comme un "je" qui n'est par lui-même rien de défini, mais qui a en face de lui un monde (antithèse) et qui devient être conscient par la connaissance de ce monde (synthèse).
Si je passe maintenant de la définition de mon être à celle du réel dans son ensemble, on peut dire que celui-ci est d'abord un "je" pensant, un esprit qui est l'être pur, qui semble un pur néant. Cet esprit produit son antithèse: le monde sensible. Puis il réalise sa synthèse avec lui et prend ainsi conscience de lui-même en devenant au sein des sociétés organisées ou États, ces réalités spirituelles que sont le Droit, la Religion, l'Art, la Morale, la Philosophie.
Dans le domaine de l’esprit, la dialectique est l’histoire des contradictions de la pensée et comment cette pensée les surmonte. Il se trouve que la négation présente par essence un caractère soustractif. Bah oui ! La négation, c’est négatif ! Donc, pour éviter l’a priori de nullité de la contre proposition, Hegel suggère de réhabiliter cet épisode en passant de l’affirmation à la négation puis de cette négation à la négation de la négation. Ainsi, il opère la conservation de la chose supprimée (négation de la négation) en la sublimant. Ce qui est sublimé est alors médié et constitue un moment déterminé intégré au processus dialectique dans sa totalité. Cette conception de la contradiction ne nie pas le principe de contradiction, mais suppose qu’il existe toujours des relations entre les opposés. Ce qui exclut doit aussi inclure en tant qu’opposé. Du coup, l’antithèse fait partie effective de la synthèse. La proposition et la contre proposition ne s’excluent plus mutuellement, mais sont toutes deux constituantes de la conclusion.
La thèse fondamentale de Hegel est que cette dialectique n’est pas seulement constitutive du devenir de la pensée, mais aussi de la réalité ; être et pensée sont donc identiques. Tout se développe selon lui dans l’unité des contraires, et ce mouvement est la vie du tout. Toutes les réalités se développent donc par ce processus qui est un déploiement de l’Esprit absolu dans la religion, dans l’art, la philosophie et l’histoire. Comprendre ce devenir, c’est le saisir conceptuellement de l’intérieur.
Hegel introduit, de cette façon la notion de temps et de passé. Il implique de tenir compte de ce que l’objet (ou l’évènement) fut. L’objet n’est plus une chose en soi, mais le résultat d’une genèse.
Pour l’anecdote, on dit qu’habitant à Iéna, il écrivait lorsque la bataille s’est déroulée et qu’il entendait les tirs de canons de son appartement. Cela le conduit d’abord à remarquer que Napoléon est un individu quelconque dont n’importe domestique connaît l’histoire individuelle. Mais cette histoire est parcellaire et inexacte si l’on ne tient pas compte des préalables extérieurs (la révolution) qui l’ont conduit là. C’est parce que Napoléon clôt la révolution qu’il est à Iéna. De là, il conclut que voyant défiler l’armée française victorieuse avec, à sa tête, Napoléon sur son cheval, il voit l’incarnation de l'Esprit. L'État devient la réalité suprême et se trouve ainsi divinisé: il est Dieu réalisé.
Je vous passe les détails, mais, ce raisonnement, lorsqu’il conclura que l’état autocratique et totalitaire du roi de Prusse est le parachèvement de la conquête de la liberté humaine, le fera bien voir par ce même Frédéric Guillaume III et la dialectique de Hegel deviendra la philosophie officielle de la Prusse.
LES PARTIS
Petit tour d’horizon de l’existant.
Le Parti Communiste
Le marxisme (suite)
Oui, je sais, des esprits chagrins m’ont déjà reproché d’avoir appelé l’article précédent « le Marxisme » et d’avoir parlé de tout sauf du Marxisme.
Attendez, bon sang ! Du calme, on y arrive !
Il me semble que vous avez une vision du monde bien métaphysique !
Métaphysique ? Qu’est-ce que ça veut dire, encore, ça ?
Bah, justement.

Pour Marx, la métaphysique, c’est la méthode de pensée qui n’est pas dialectique. C’est voir les choses de façon abstraite sans tenir compte de ce qui est autour, avant et après. C’est une vision pointilliste et discontinue de l’univers.
Marx abonde tout à fait dans le sens de la pensée de Hegel. Cependant, il reproche à Hegel sa vision du monde idéaliste. Il considère que Hegel marche sur la tête et selon sa propre expression, il envisage de « remettre Hegel sur ses pieds ». Pour Hegel, la dialectique est la loi de la pensée; et ce qui existe, le réel est la pensée réalisée. Marx renversera ce schéma de Hegel. Pour Marx, au contraire, la dialectique n’est pas la loi de la pensée, mais la loi de la matière. Celle-ci évolue dialectiquement, et la pensée n’est que le reflet de la matière.

Alors, maintenant, je vais pouvoir vous présenter le matérialisme dialectique. En fait, je suis très paresseux et, voyez ma chance, il se trouve que j’ai découvert un texte sur le NET. Je présume que c’est une présentation faite par un marxiste. Cela me semble clair et pas trop long. Je vous le livre donc texto. Je n’en connais pas l’auteur sinon, je vous l’aurais indiqué. Tant pis pour lui, il n’aura pas la gloire d’être cité nommément dans les pompes de mon site.
Bien fait pour lui, il n’avait qu’à assumer.
Le matérialisme dialectique
Le matérialisme s'oppose à l'idéalisme
Au temps de la communauté primitive, les hommes n'avaient pas les moyens d'expliquer les phénomènes naturels. Ils projetaient donc sur les choses leur propre pensée. Ils personnifiaient les phénomènes et mettaient un esprit derrière chacun: l'esprit de la source; l'esprit du soleil; celui du vent, du feu, etc.

Le progrès des connaissances scientifiques va tordre le cou à bien des " esprits ".
L'évolution de la pensée religieuse aboutit à des religions à dieu unique (on dit: monothéistes). Auparavant, c'était une multitude d'esprits qui créaient le réel. Désormais, c'est un esprit
unique qui est à l'origine de la création de toute chose. Dans un cas comme dans l'autre, face à l'inconnu, l'individu ne cherche pas à comprendre.

Il s'agenouille devant le mystère, identifié à Dieu. " Dieu l'a voulu ", " c'était écrit "... C'est une espèce de fatalisme devant notre état d'ignorance. L'attitude des matérialistes est toute autre, s'il y a des choses inconnues, il n'y a rien qui soit inconnaissable.
Ce fatalisme ne se rencontre pas seulement chez les " croyants ". Il imprègne toute la société. On entend souvent, par
exemple, des gens athées dire: " c'est le destin !".

Ils mettent ainsi, sans le vouloir, une volonté aux commandes du monde; ou tout du moins une programmation; un déterminisme, ce qui revient au même. Ces façons de voir, tout comme les croyances primitives et religieuses, sont des conceptions idéalistes.
Qu'est-ce que l'idéalisme ?

C'est la philosophie qui explique le monde par la " primauté " de l'esprit sur la matière. L'idéaliste prétend que les idées des hommes sont le produit de leur propre volonté. Certains philosophes sont allés très loin dans ce sens. Un évêque anglais du 17ème siècle, Berkeley, a ainsi développé une théorie selon laquelle l'univers n'existerait que par nous. Ce serait notre conscience qui créerait et recréerait le monde à chaque instant. Ce point de vue est le plus extrême de la philosophie idéaliste. On l'appelle le solipsisme. Mais, sans aller jusque là, les philosophes idéalistes pensent que la conscience est l'unique principe créateur. Ils considèrent que les idées, en s'engendrant les unes les autres, déterminent l'histoire du monde.
Ces principes idéalistes imprègnent toute la société. Et cela, en particulier, à travers la religion; mais pas seulement. Ainsi les fonctionnaires qui confondent le règlement avec la réalité. Ainsi les juges qui croient que leurs lois sont aussi éternelles que la loi de la pesanteur. Ainsi les politiciens qui déifient la démocratie, etc.
Mais ils sont incapables d'expliquer d'où viennent ces idées; en quoi leurs lois, leurs règlements, leurs décisions etc. déterminent effectivement le cours des événements. Ils ne peuvent pas expliquer le processus de la pensée.
Et nous-mêmes ne portons-nous pas, nous aussi, ces conceptions ? Confrontés à l'éducation d'un enfant, ne cherchons-nous pas à lui donner nos idées comme on achète un vêtement prêt-à-porter ? Face à notre entourage, n'avons-nous pas l'illusion de pouvoir convaincre par la seule force de ce que nous affirmons ?

Les contradictions c'est la vie
Toute chose est un processus. C'est à dire qu'elle évolue. Malgré les apparences de stabilité, tout phénomène est changeant. Une étoile, un océan, un fleuve, un nuage, un être vivant, un pays, une usine, un système de production, une théorie... Tout a une naissance, un développement, puis une mort. Cette mort n'est en fait qu'une transformation en quelque chose de nouveau; en d'autres phénomènes, qui eux-mêmes auront un développement et une mort...
Deux conceptions du changement
Dans l'histoire de la connaissance humaine, il a toujours existé deux conceptions des lois du développement du monde: l'une métaphysique, l'autre dialectique.
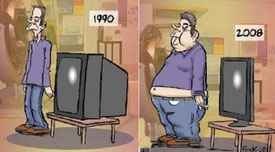
La métaphysique considère toutes les choses comme isolées; étrangères les unes aux
autres et en état de repos. Bien sûr, elle reconnaît le changement. Mais c'est seulement en tant qu'augmentation ou que diminution quantitative; ou en tant que simple déplacement. Et les causes
de tels changements, elle les fait résider en dehors des phénomènes. Par exemple, elle expliquera le développement des sociétés par des forces extérieures à ces sociétés: le milieu géographique,
le climat etc.

Elle expliquera la chute d'une pomme par la force du vent et la loi de la pesanteur.
La méthode dialectique considère au contraire que l'évolution des choses est régie par leur dynamique interne. La pomme
mûrit, tombe, puis pourrit; pour donner un nouveau pommier. Nous-mêmes, nous vieillissons et nous mourrons un jour; même si nous n'avons pas d'accident ou de maladie... parce que la mort est
nécessaire à la vie.

Mais enfin, ce sont bien le vent et la pesanteur qui font tomber la pomme ? ! Et bien non ! Ce sont
ceux qui décident du moment où elle se décroche et de l'endroit où elle atterrit sur le sol; mais pas du fait qu'elle tombe, de toute façon. La dialectique ne nie pas les forces extérieures; ni I'interaction entre tous les éléments de la réalité. Mais elle affirme que ces forces agissent sur la base de la nature interne des phénomènes. Le secret d'un phénomène est à l'intérieur de lui-même.
Connaître un phénomène, c'est comprendre ses contradictions

Pour comprendre un phénomène, il faut donc examiner son architecture interne. Il faut analyser ses différents aspects. Par exemple: une société est composée de plusieurs classes; un système écologique est composé de plusieurs espèces vivantes; une réaction chimique met en œuvre divers composants... Il faut ensuite voir les rapports qui associent les différents éléments de ce phénomène, et comprendre chaque rapport comme une unité de contraires. La chaîne écologique a besoin des renards pour manger des corbeaux... et des corbeaux pour bouffer la charogne des renards. La vie n'existe que parce qu'il y a la mort.

Chaque phénomène a des contradictions particulières; on dit aussi " spécifiques ". Il est parfois difficile de repérer les contradictions essentielles et de comprendre comment elles s'articulent. Car elles n'ont pas toutes la même importance. Dans le tissu des contradictions qui constituent un phénomène, l'une d'entre elles joue un rôle essentiel. On l'appelle contradiction fondamentale, ou contradiction principale. C'est elle qui détermine la nature du phénomène. De même, entre les deux aspects d'une contradiction, I'un est dominant. On dit que c'est l'aspect principal de la contradiction.
Contradictions principales et contradictions secondaires
Un phénomène est donc déterminé par sa contradiction principale. Avant que cette contradiction existe, le phénomène n'existait pas. Si la contradiction disparaît, le phénomène disparaît sous sa forme actuelle. C'est à dire qu'il se transforme en quelque chose d'autre, qui sera déterminé par une nouvelle contradiction principale.
Les autres contradictions qui parcourent le phénomène sont des contradictions secondaires. Par exemple: la contradiction cadre / salarié dans la société d'aujourd'hui; la contradiction maître / compagnon sous le féodalisme, etc. Le fait qu'une contradiction soit secondaire ne veut pas dire qu'elle est sans importance. Cela signifie simplement que son action reste dominée par le mouvement de la contradiction principale. Elle lui est subordonnée. De plus, une contradiction secondaire peut devenir principale, et une contradiction principale peut devenir secondaire. Ainsi la contradiction maître / compagnon, secondaire sous le féodalisme, s'est développée sous le capitalisme pour devenir sa contradiction principale: bourgeoisie / prolétariat. La contradiction principale du féodalisme, seigneurs / serfs, est devenue aujourd'hui secondaire sous la forme d'une contradiction aristocratie / paysannerie.
L'aspect principal de la contradiction

Les contradictions ne sont pas seulement hiérarchisées entre elles. Chaque contradiction est constituée de deux aspects opposés. Mais ces deux aspects n'ont pas la même importance. Il y a toujours un aspect principal... et un aspect secondaire. L'aspect principal, ou dominant, constitue le facteur dirigeant de la contradiction. L'aspect secondaire, ou dominé, constitue la base de cette contradiction. Dans le couple classes dominantes / salariat aujourd'hui, c'est les classes dominantes qui est le facteur dirigeant et le salariat qui représente la base. Les deux aspects d'une contradiction, sous certaines conditions, peuvent inverser leurs rôles. Ainsi les salariés peuvent devenir dominant... à l'occasion d'une révolution.
L'unité et la lutte au sein de la contradiction

Pour qu'un phénomène existe, il faut que les deux aspects de sa contradiction principale coexistent durablement. C'est cette coexistence qui fait la stabilité relative du phénomène. Cette coexistence, cette unité des deux aspects, s'établit à travers une lutte entre eux; à travers leur opposition permanente. C'est cela qu'on appelle l'unité des contraires.
Prenons la société capitaliste: là où il y a exploitation, il y a lutte. Et c'est pourtant à travers l'exploitation du prolétariat que le capital, et donc la bourgeoisie, se développent. En retour, ce développement accroît l'importance du prolétariat dans la société...
Dans le processus de développement d'un phénomène, chacun des deux aspects d'une contradiction suppose l'existence de l'autre aspect, qui est son contraire. Et c'est à travers leur lutte permanente que se maintient leur unité.
A l'intérieur de chaque phénomène, dans le couple dialectique " unité/lutte ", l'unité est I'aspect principal. En effet, sans une domination relative de l'unité, il n'y aurait pas d'objet stable s'offrant à l'examen. Nous-mêmes, nous n'existerions pas. Mais rien n'est éternel. C'est à dire qu'aucune chose n'est gelée durablement dans son état. L'unité est conditionnée, temporaire, passagère, relative... La lutte des contraires est absolue. Et cette lutte des contraires, au niveau de la contradiction principale qui caractérise un phénomène, le fait évoluer vers sa fin: vers l'antagonisme.
L'antagonisme
L'antagonisme est l'une des formes que prend la lutte des contraires. C'est l'état de conflit ouvert qui apparaît dans certaines conditions.
La contradiction principale d'un phénomène s'accentue au cours de son développement et tend inévitablement à devenir antagonique. Mais l'antagonisme n'est pas un caractère permanent de la contradiction; ni un caractère qu'aura obligatoirement toute contradiction au cours de son existence.

Changement progressif et changement par bond
Certains savants considèrent que "la nature ne fait pas de sauts". Ce sont des adeptes du "gradualisme". Les politiciens bourgeois sont gradualistes. Ils voient la société comme avançant régulièrement vers un progrès infini. C'est ce qui fonde les positions politiques des réformistes.
En fait, pas besoin d'être grand sorcier pour observer ces sauts de la nature. Un homme meurt; un astre explose dans le
ciel; la terre tremble subitement... Mais qu'est-ce qui fonde ces événements ? C'est que, tout au long de sa période de stabilité apparente, le phénomène a connu des changements mineurs,
imperceptibles parfois. Il s'est modifié; mais les changements n'ont été que quantitatifs. Ce sont les toxines qui s'accumulent dans un organisme. C'est l'hydrogène d'une étoile qui s'épuise. Ce
sont les tensions qui s'accumulent dans les profondeurs de la terre en un point donné...

Arrivé à un certain stade d'accumulation quantitative, un changement qualitatif s'opère, qui fait l'événement. Cet événement correspond à la modification brutale ou à la disparition d'un phénomène. Il peut s'agir d'une contradiction principale, qui devient antagonique, puis disparaît. Il peut s'agir d'une contradiction secondaire qui devient principale; ou de l'aspect principal qui se déplace sur I'autre terme au sein d'une contradiction...
Conclusion
Le matérialisme dialectique est donc une méthode d'investigation de la réalité. C'est un guide pour l'action, qui permet d'aborder, de comprendre et de résoudre les problèmes que nous rencontrons.
Le marxisme (fin)
Vous voici donc parés pour ce qui est de la dialectique matérialiste. Rassurez-vous ! Il n’y a pas que ça. La dialectique matérialiste, ce n’est que l’outil qu’utilisent les marxistes pour réfléchir. Mais, un outil que l’on n’utilise pas, c’est quand même un peu inutile.
Il y a une chose amusante sur laquelle je voulais aussi attirer votre attention, c’est une guerre des mots qui va opposer les marxistes et leurs détracteurs. Marx et son ami Engels vont dans leurs spéculations intellectuelles utiliser un certain nombre de concepts et leurs opposants vont s’ingénier, et c’est de bonne guerre, à en dénaturer le sens.
D’abord, il y a la sacro-sainte lutte des classes. Il est de bon ton de dire que la lutte des classes c’est dépassé.
C’est absurde.
Déjà, le mot lutte est dévoyé. On laisse pressentir que par luttes, on entend émeutes et grèves violentes avec affrontement physique allant jusqu’aux fusillades et à l’héroïsme pathétique des pétroleuses.
Effectivement, ça, ça ne se voit plus. Mais, ce n’est pas de cela qu’on parle. Peut-on réellement prétendre qu’il n’y a plus, dans la société, deux catégories d’individus ? Ceux qui ne vivent que de leur travail et ceux qui ne vivent que du travail des autres. Au sens strict de la dialectique de Marx (et même de Hegel), la société présente bien cette contradiction interne. Et cette opposition de fait est même ce qui génère la vie de la société. Dire que la lutte des classes est dépassée, c’est donc laisser entendre que les salariés et petits exploitants n’ont plus de raison de lutter pour améliorer leur sort. C’est dépassé ! Ceci n’est pas le constat d’une évolution de la société mais juste la négation d’une appréhension dialectique du monde.
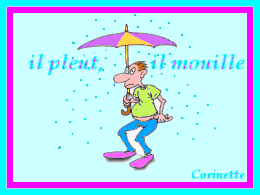
Avec un mode de réflexion dialectique, c’est aussi pertinent que de dire que la succession des anticyclones et des dépressions atmosphériques, c’est dépassé. Dépassé ou pas, il faudra quand même acheter des parapluies.
Qu’on le veuille ou non, la société est bien constituée de groupes antagonistes. La lutte des classes n’est pas une volonté révolutionnaire, mais un constat d’une évidence matérielle.
Dire que la lutte des classes est dépassée n’est pas un constat historico-sociologique. C’est la négation pure et simple d’un fait. Nier un fait tangible et vouloir le remplacer par un vœu pieux, c’est avoir une disposition d’esprit ou le souhait l’emporte sur la réalité. C’est justement ça qui s’appelle l’idéalisme. Même avec le jugement du plus rudimentaire matérialisme, on constatera que ce n’est pas en décrétant que l’injustice sociale n’existe plus que celle-ci est supprimée.

Le deuxième sujet, c’est la dictature du prolétariat.
Là, le dévoiement lexical joue, plus drastiquement, sur les deux mots.
La dictature.
Mot sinistre s’il en est.
En effet, à travers l’histoire, on a gardé le souvenir sanglant de personnages dictatoriaux. Le vingtième siècle a, de plus, été remarquablement riche de ces aventures d’épouvante. Pour les détracteurs du marxisme, il est confortable d’assimiler le mot de Marx à ces visions dignes de Dante (Alighieri 1265 1321). Il faut reconnaître que l’époque stalinienne de l’URSS dont je vous reparlerai plus tard a bien permis de justifié cette perversion de l’expression de Marx.
En fait, ce n’est pas de cela qu’il s’agit.
Mais, avant d’aller plus loin, voyons le mot prolétariat. Je sais, je vous en ai déjà parlé mais je vais réitérer. La pédagogie, c’est l’art de la répétition.
Au mot prolétariat, on peut donner trois sens différents.
D’abord, et je l’ai déjà dit précédemment, à Rome, ce sont des citoyens tellement pauvres que, ne payant pas l’impôt, ils ne peuvent rien donner d’autre à Rome que les enfants qu’ils ont procréés.
Deuxièmement, le sens que Marx choisit est : ceux qui n’ont pas d’autres moyens de survie que le salaire qu’ils touchent.
A ce titre, on peut constater que pour Marx, un ingénieur (s’il n’est que salarié), un administrateur (s’il n’est pas actionnaire), un médecin qui ne pratique pas de dépassement d’honoraire, un haut fonctionnaire (recteur d’académie, préfet), un magistrat, et bien sûr tous les enseignants de la maternelle à l’université sont des prolétaires. Attention, je n’ai pas dit qu’ils faisaient partie de la classe ouvrière ! C’est autre chose. Je vous en reparlerai sans doute un jour. Et c’est là que le troisième sens survient comme une hérésie.

On entend souvent, par prolétaire, les salariés de petit niveau exclusivement. Voire même, de préférence, les travailleurs manuels. Ceux qui n’ont pas d’autre vêtement que leur bleu de travail. Bref, on entend souvent par prolétaire ce que la gouaille populaire appelle familièrement et tendrement les « prolos ». C’est un contre sens. S’il ne s’agissait que d’une erreur sémantique, cela ne serait pas grave. Hélas, ceci entraîne une perversion de tout ce qui tourne autour de la notion de prolétariat. Tenez, à titre d’exemple, j’ai connu un directeur d’école primaire qui, par sympathie envers les opprimés et pour se rapprocher d’eux, pour faire « prolo », quoi ! Affectait de venir diriger son groupe scolaire déguisé en ouvrier métallurgiste. Il ne réalisait pas que, ce faisant, au lieu de rendre service à ses amis, il les confortait, au contraire dans une vision du monde où la culture et le savoir étaient méprisables.

Revenons, maintenant à notre expression de dictature du prolétariat. Elle est maintenant confondue avec dictature des prolos. Si vous la regroupez avec cette notion que « les intello, ils nous emmerdent », nous en arrivons nécessairement à la dictature de la médiocrité. Cela reviendrait à dire que Marx, s’il était vivant, étant un intellectuel, n’aurait pas voix au chapitre. C’est un peu paradoxal, non ?
Alors, maintenant, revenons en à notre dictature du prolétariat avec un éclairage marxiste. La société est divisée en classes antagonistes. C’est sa contradiction interne première. La bourgeoisie est la classe dominante et le prolétariat la classe dominée. Dans la situation actuelle, La bourgeoisie dicte sa loi au prolétariat. C’est donc un dictat bourgeois. On peut le désigner comme dictature de la bourgeoisie. Marx suggère d’inverser les rôles et que ce soit le prolétariat qui dicte sa loi à la bourgeoisie. Donc, d’établir une dictature du prolétariat.
Avec ce nouvel éclairage, on est loin de Staline ou de Franco et le prolétariat n’est pas nécessairement le regroupement des plus « grandes gueules » au détriment des théoriciens de la vie en société. Pour simplifier, au sens marxiste du terme, dire je suis contre la dictature du prolétariat, cela revient à dire : Je suis pour la dictature de la bourgeoisie.
Suis-je clair ?
Un troisième terme est perverti. Il s’agit de la notion de révolution.
Le sens premier est le retour d’un objet à son point de départ après avoir fait le tour d’un autre. Par exemple la terre effectue une révolution autour du soleil en un an. Par extension, on parle de révolution des esprits. Je sais, ce terme est un peu faux puisque les esprits ne reviennent pas à leur point de départ, mais, précisément, s’en écartent. Il serait, effectivement plus pertinent de parler de rotation, de retournement ou de déhiscence (une chose qui se retourne comme une chaussette, l’extérieur se retrouvant à l’intérieur. Mais bon, que voulez-vous que j’y fasse, on dit révolution. On parle de révolution industrielle, de révolution artistique et tant d’autres. Aux gens qui se disent révolutionnaires sur le plan socio-politique sont taxés de violence. C’est, a priori, inepte.
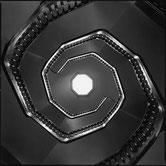
En fait, on confond la révolution avec les évènements qui souvent l’accompagnent.
Il va de soi que si Jojo veut prendre la place de Bébert, même si c’est très justifié, celui-ci ne va pas se laisser faire. Il s’en suit que la chose risque de se faire avec certains débordements violents. Est-ce une obligation ? Les mouvements de violences sont liés, non pas à la révolution, mais aux émeutes qui y conduisent. En 1789, la révolution ne s’est pas faite le 14 juillet, mais dans les mois qui ont suivi. La révolution, par essence est pacifique. L’insurrection qui y conduit ne l’est pas forcément.

Du coup, des émeutes ou des insurrections peuvent ne pas avoir d’aboutissements novateurs et réciproquement, une révolution peut ne pas être le fruit de luttes sanglantes.
En clair, une insurrection peut ne pas être révolutionnaire et une révolution ne pas être insurrectionnelle. Il se trouve, que fréquemment, une révolution est la résultante d’une insurrection. Certains en ont tiré la conclusion que c’était une nécessité.
Auguste Blanqui (déjà cité) pensait que seule une insurrection pouvait conduire à une révolution. Pendant longtemps, suite à la révolution russe de 1917, les communistes ont cru comme en un dogme en cette nécessité de l’insurrection révolutionnaire de type blanquiste. Si je reprends l’image utilisée lors de l’explication de la dialectique marxiste, c’est considérer que pour que la pomme tombe plus tôt, il faut un coup de vent. Or, cette même dialectique expose que même sans le coup de vent, la pomme tombera.
J’ai souvent entendu des gens dire qu’ils sont pour une mutation, une transformation de la société mais qu’ils ne sont pas révolutionnaires. En fait, ils se trompent. Ils veulent dire qu’ils sont révolutionnaires mais qu’ils sont opposés à des mouvements insurrectionnels. Si, de plus on considère qu’une insurrection peut ne pas aboutir et justifier la répression, j’aurais tendance à penser comme eux. La seule nuance, c’est que moi, et ceci parce que j’essaie de comprendre le sens des mots, je ne me sens pas spécialement violent, mais révolutionnaire, ça, oui. Jusqu’au bout des ongles !
Il va de soi que je ne vous ai pas tout raconté ce qu’on peut dire sur Marx. Pour ça, je vous conseille de lire ne serait-ce que le « Manifeste du parti communiste ». Et puis tout ce que vous voulez. Cependant, si vous voulez avoir une idée de ce que dirent les marxistes, lisez leurs œuvres et pas celles de leurs opposants. Sinon, c’est l’avis des opposants que vous aurez et pas les leurs.
Et puis, tenez, avant de vous laisser à votre béatitude mentale pour quelques jours, je voudrais vous soumettre ces quelques constatations.
Si on en revient aux perversions de langage évoquées plus haut, cela m’incline à une pensée qui les regroupe bien.
Dire que la lutte des classes c’est dépassé, cela arrange qui ? Ceux qui veulent voir évoluer cette lutte des classe ou ceux qui veulent la maintenir en l’état ?
Dépeindre la dictature du prolétariat comme une situation malfaisante et sanguinaire, cela arrange qui ? Ceux qui veulent voir triompher le prolétariat ou ceux qui préfèrent voir prorogée la dictature de la bourgeoisie ?
Ravaler la notion de prolétariat à une catégorie de personnes que l’on persuade qu’il est bon de mépriser toute forme de savoir et de culture, cela arrange qui ? Ce prolétariat lui même ou ceux qui sont nantis par la grâce de cette situation ?
Laisser entendre qu’une révolution est nécessairement une vague sanguinaire et dévastatrice, cela arrange qui ? Ceux qui auraient intérêt à ce que la société, se retournant sur elle même, leur apporte moins d’injustices ou ceux qui profitent de ces injustices ?
C’est drôle, hein, tout ça !
Cela me rappelle une constatation de je ne me souviens plus quel barbu marxiste du passé (si quelqu’un le sais, qu’il me le dise, je le rajouterai) :

Les idées dominantes sont
toujours
celles de la classe dominante.
C’est drôle, hein, tout ça. Mais je ne sais pas si vous remarquez à quel point nous sommes éloignés, sur le plan intellectuel, des marchandages, des maquignonnages, des « grenouillages » de la description des partis précédents. Hélas, tout ceci, nous le verrons, n’est que dans le domaine théorique.
Voilà braves gens votre dose, votre picotin de méditation intellectuelle hebdomadaire. Si vous êtes sages, dans le chapitre prochain, je vous parlerai de l’URSS.
LES PARTIS
Petit tour d’horizon de l’existant.
Le Parti Communiste
L’URSS
Comme je vous le disais précédemment, il est difficile de parler du parti communiste français sans faire un petit détour par ce que fut l’URSS. Sa naissance, son évolution et, son histoire et sa fin.

Rassurez-vous, je vais simplifier et raccourcir de façon drastique.
Si vous voulez en savoir plus, bah, il faut vous renseigner.
Hé ! Je ne vais tout de même pas toujours vous donner la main pour traverser la rue !


Bon, revenons à nos moutons. Dans la deuxième moitié du dix neuvième siècle, la Russie est encore très
archaïque. A partir de 1860, le Tsar (Alexandre II) promet des réformes (abolition du servage en 1861). Dans un premier temps, cela calme un peu les esprits de son Empire mais cela ne dure pas.
Les attentats se succèdent. L’état est en pleine décomposition. Les émeutes se multiplient et le tsar revient à une politique de répression qui sera encore majorée par ses successeurs (Alexander
III et Nicolas II) lorsqu’il sera assassiné en 1881. De 1881 à 1904, la Russie vit pratiquement dans un état d'urgence ou un état de siège quasi permanent. En
parallèle, elle connaît un rapide essor économique. La Révolution industrielle russe date des années 1890. Comme au Royaume-Uni 150 ans plus tôt, comme en France 60 ans plus tôt, comme en Allemagne 30 ans plus tôt, la révolution industrielle
entraîne le développement de trois classes sociales nouvelles : la bourgeoisie d'affaires, puis la classe moyenne et la classe ouvrière.

Il s’en suit que le mécontentement ne cesse de croître parce que la société russe se transforme, mais que le système politique ne semble pas vouloir évoluer.
Le Tsar avait espéré redorer son aura en guerroyant contre le Japon, mais c’est le contraire qui se produit. Cette guerre est trop lointaine et en plus, elle est catastrophique… Entre 1900 et 1905, on compte plusieurs centaines d’émeutes dans les campagnes. Toutes férocement réprimées.



En janvier 1905, une procession menée par un prêtre se rend au palais d’hiver (à saint Petersbourg) pour remettre une supplique au Tsar. On tire ; il y a de très nombreux morts et blessés (au total plus de mille). C’est le dimanche rouge. Le Tsar a définitivement perdu la confiance du peuple. A partir de là, c’est une succession de grèves et d’émeutes. Les opposants réclament une Douma (chambre représentative), une réforme

agraire, les droits fondamentaux et une monarchie constitutionnelle. Le Tsar promet et ne tient pas.

Au printemps, la situation se radicalise de plus en plus. L’armée et la marine sont lasses et
mécontentes. Cela entraîne la fameuse mutinerie du cuirassé Potemkine qui si elle n’est pas politisée n’en reste pas moins significative. La répression est féroce et la fusillade dans les
escaliers d’Odessa a vraiment eu lieu. Une douma est élue mais elle n’est que consultative et jamais écoutée.

De plus, elle est dissoute et remplacée par une autre élue sur d’autres bases et strictement favorable à l’aristocratie. A la fin de 1905, le pouvoir redevient strictement autocratique. Un peu partout, cependant, les gens : ouvrier, paysans, marins, soldats, habitants de quartiers, etc., ont pris l’habitude de se regrouper en assemblées de tailles variables et de discuter entre eux.

Je sais que vous possédez parfaitement la langue, mais je vais quand même vous dire comment se nomment ces réunions en russe. Ces assemblées s’appellent des « soviets ».
Arrive la première guerre mondiale. Rapidement la situation sur le front est catastrophique. Les victimes tués ou
blessés se comptent par millions. La logistique est impuissante. La famine gronde dans l’armée comme dans le pays.

Dès 1915-1916, une prolifération de comités divers prend en main tout ce qu’un État déficient n’assume plus (ravitaillement, soins, échanges). Avec les coopératives ou les syndicats, ces comités deviennent des pouvoirs parallèles. Le régime ne contrôle déjà plus le « pays réel ».
Le 23 février (8 mars du calendrier moderne), pour la journée internationale, des femmes de Petrograd manifestent pour
réclamer du pain

L'action est soutenue par la main-d’œuvre industrielle. Ce premier jour, malgré quelques confrontations avec les forces de l’ordre, il n’y a aucune victime.
Les jours suivants, les grèves se généralisent dans tout Petrograd et la tension monte. Les slogans, jusque-là plutôt discrets, se politisent : « À bas la guerre ! », « À bas l’autocratie ! ». Cette fois, les affrontements avec la police font des victimes des deux côtés. Les manifestants s’arment en pillant les postes de police. Après trois jours de manifestations, le Tsar mobilise les troupes de la garnison de la ville pour mater la rébellion. Les soldats résistent aux premières tentatives de fraternisation et tuent de nombreux manifestants. Toutefois, la nuit, une partie de la troupe rejoint progressivement le camp des insurgés, qui peuvent ainsi s’armer plus convenablement.

Tous les régiments de la garnison de Petrograd se joignent aux révoltés. C’est le triomphe de la révolution. Sous la pression de l’état-major, le tsar Nicolas II abdique le 2 mars. C’est de fait la fin du tsarisme, et les premières élections au soviet des ouvriers de Petrograd. La chute rapide et inattendue du régime, suscite dans le pays une vague d’enthousiasme, de libéralisation, d’espoir et d’allégresse.

Des gouvernements provisoires sont nommés, mais la situation et leur immobilisme, leurs positions conservatrices également les discréditent rapidement.
Au début, les soviets n’osent pas trop les contredire mais, peu à peu, la continuation de la guerre et la misère toujours présente vont conduire les soviets à se retourner vers un parti qui, s’il est petit au regard de la nation russe n’en est pas moins (théoriquement), selon les moments, majoritaire dans les partis socialistes du moment. Majoritaire, en russe, cela se dit bolchevik.
Je vous passe les détails qui, par certains aspects, pourraient tenir lieu de bouillonnement épique. Si cela vous amuse, il y a des gens très bien qui ont raconté tous les retournements jour par jour entre février et octobre.
Toujours est-il qu’en octobre, le mécontentement à refait surface. Le parti bolchevik est très largement majoritaire dans les soviets avec ses mots d’ordre : la terre à ceux qui la travaillent, les usines aux ouvriers, la journée à huit heures, la paix tout de suite, des élections générales pour la Douma et tout le pouvoir aux soviets.
Pour la compréhension de la suite, je dois maintenant vous présenter deux personnages clef du moment : Lénine et Trotski.

Lénine : (de son vrai nom Vladimir Illich Oulianov 1870 1924). Fils d’un fonctionnaire de l’enseignement fait des études de droit mais s’intéresse plus aux écrits de Marx qu’il cherche à faire connaître. Emprisonné et déporté en Sibérie, il est membre du parti social démocrate russe et lors de la scission de celui ci en 1905, il devient le dirigeant de la faction majoritaire (bolchevik). Pour des raisons de sécurité, il erre un peu à travers l’Europe. En 1917, il revient à Petrograd. Depuis février, les divers gouvernements provisoires auxquels participent les menchevik (les autres, donc) se discréditent progressivement.
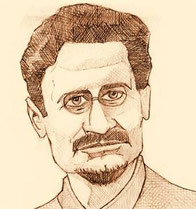
Trotski : (de son vrai nom Lev Davidovitch Bronstein 1879 1940) Né en Ukraine d’une famille de fermiers juifs, abandonne des études de mathématiques pour se consacrer à son action parmi les sociaux démocrates russes de son époque. En 1905, il devient président du soviet de Petrograd. Celui-ci est dominé par des mencheviks. A ce moment, il connaît depuis quelques années Lénine avec lequel à quelques exceptions près, il partage d’assez larges vues étant marxistes tous les deux. Redevenu président du soviet de Petrograd, en octobre 1917, il prend une part déterminante à la révolution, devient « ministre » des affaires étrangères, réorganise l’armée qui deviendra l’armée rouge et devient ministre de la guerre. La guerre civile entre 1918 et 1922 verra son aboutissement surtout grâce à son sens de l’organisation et sa détermination. Par la suite, après la mort de Lénine, il se heurtera à Staline et, chassé d’URSS, il sera assassiné par un agent de celui-ci en 1940 au Mexique.
Revenons donc à la révolution d’octobre. Dans les faits et pour la prise du pouvoir, nous assistons à un acte concerté. Trotski a soigneusement organisé les actions à accomplir et Lénine a même choisi la date. Même si les nombres d’individus mis en cause par les quelques combats sont minimes, la prise du pouvoir ne pouvait pas ne pas réussir. L’immense masse des bolcheviks était derrière eux et personne ne s’est vraiment interposé. Il a suffit d’une insurrection planifiée comme la préconisait Auguste Blanqui un demi-siècle plus tôt en France. Le fruit était mûr et il est tombé.
Cependant, la prise du pouvoir étant réussie ou pas, les problèmes restaient les mêmes. La désorganisation totale du pays, la misère mélangée de famine et la guerre sont toujours là.

Pour ce qui est de la guerre, un différent a pendant quelques temps opposé Lénine et Trotski. Lénine était partisan de la paix à tous prix. Inversement, Trotski, ayant en tête l’image de l’armée de la révolution française après 1791 qui apportait les droits de l’homme aux peuples d’Europe, pensait que la jeune armée rouge devait se transformer et, n’étant plus une armée impérialiste du tsar, devenir une armée révolutionnaire qui allait apporter la révolution prolétarienne aux autres peuples d’Europe et du monde.
Lénine et Trotski étaient bien d’accord sur le fait que la révolution, si elle n’était pas mondiale serait un échec puisque toutes les puissances se ligueraient contre la jeune nation prolétarienne.
En même temps, Trotski pouvait appuyer ses intentions par le fait que sur tous les fronts, on constatait des mutineries et les scènes de fraternisations entre combattants opposés étaient fréquentes. Trotski réussit donc à convaincre Lénine. Cependant, l’armée russe est en pleine décomposition. Les soldats ne veulent plus se battre et cela tourne à la catastrophe. On en revient donc à la première solution et la Russie signe une paix séparée.
On pourrait supposer que les choses vont donc s’arranger.
Il n’en est rien.
Profitant de la situation chaotique, des groupes de tous ordres se sont armés et une guerre civile
féroce commence. Les bolcheviks vont bien sûr s’opposer aux mencheviks, mais, de plus, on verra des armées anarchistes, nationalistes (et même plusieurs opposées pour les mêmes régions), les SR
(socialistes révolutionnaires) qui veulent voir dans la paysannerie le ferment de la révolution et non les ouvriers comme le pensent les bolcheviks.

Ces SR avaient été et restaient des partisans des attentats politiques, image romantico-passionnelle et individualiste de la révolution comme exaltation, sans véritable but concerté, de l’action et de l’engagement. Bien sûr, il s’est constitué des armées tsaristes (les blancs) envisageant de revenir à l’ancien régime et, dans le même temps, les puissances occidentales envoient des corps expéditionnaires pour soutenir tantôt les tsaristes, les nationalistes ou les mencheviks. Ajoutez à cette confusion des corps francs et des mercenaires (surtout chez les cosaques) qui s’allient tantôt aux uns et tantôt aux autres, n’hésitant pas à changer de camp en pleine bataille selon les promesses de rétributions.
Quand cette situation se termine vers 1922, la Russie (devenue entre temps Union des Républiques Socialistes Soviétiques) est en ruine et exsangue. Cependant, les bolcheviks ont la certitude de pouvoir, maintenant assumer la dictature du prolétariat.
Mais la santé de Lénine décline. Il a, de plus, et indépendamment de cela, été victime d’un attentat (fomenté par les SR) dont il ne se remettra vraiment jamais.

Un nouveau personnage apparaît : Staline.
Joseph (Iossif) Vissarionovitch Djougachvili 1878 1953, généralement connu sous le nom de Joseph Staline a dirigé l'Union soviétique seul pendant vingt-cinq ans, entre la fin des années 1920 et 1953. De 1922 à 1953, il fut secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. Il a utilisé le pseudonyme de Staline, formé sur le mot russe (stal), qui signifie acier.
Par un jeu patient d'intrigues souterraines et d'alliances successives avec les diverses factions du parti unique bolchevik, et en s'appuyant sur la toute-puissante police politique et sur la bureaucratisation croissante du régime, il accéda progressivement au pouvoir personnel absolu, et transforma l'URSS en un régime de type « totalitaire » dont le culte obligatoire rendu à sa propre personne fut un des traits les plus marquants. Entreprenant d'arracher spectaculairement le pays à son arriération ancestrale, il fit nationaliser intégralement les terres, et industrialisa l'Union soviétique à marche forcée par les très ambitieux et souvent irréalistes plans quinquennaux, sans souci des oppositions, brisées, ni du lourd coût humain et social. Son long règne fut marqué par un régime de terreur et de délation paroxystique, encore plus prégnant en temps de paix qu'en temps de guerre, et par la mise à mort ou l'envoi aux camps de travail du Goulag de millions de personnes généralement innocentes, notamment au cours de la collectivisation des campagnes et des Grandes Purges de 1937. Il pratiqua aussi bien des déplacements de population massifs, dont la déportation intégrale d'une quinzaine de minorités nationales, que la sédentarisation forcée non moins désastreuse de nomades d'Asie centrale. Il nia aussi l'existence des famines meurtrières de 1932-1933 et de 1946-1947 après les avoir en partie provoquées par sa politique brutale. Le secret et la propagande systématiquement entretenus autour de ses actes firent du travestissement de la réalité et de la réécriture du passé une caractéristique permanente de son pouvoir absolu.
Comme je suis paresseux et que je ne voyais pas trop comment résumer tout Staline en une demi-page, je l’ai piquée dans Wikipédia. Je trouve la synthèse pas trop réductrice bien que nécessairement tronquée. Alors, je vous l’ai livrée telle qu’elle.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, je trouve qu’on est assez loin de la dialectique matérialiste d’une part et de « tout le pouvoir aux soviets » d’autre part.
Dans le prochain article, il me restera à vous présenter ce que fut l’URSS sous Staline, sa lente décrépitude et sa fin.
L’URSS (2)
Nous sommes donc vers 1920. Le foisonnement révolutionnaire, s’il n’est plus à son sommet existe
encore.

La direction collégiale du parti bolchevik n’est pas encore remise en cause mais la guerre civile a fait, déjà, ses ravages. La situation économique est désastreuse. Lénine décline et se méfie de plus en plus de Staline. Il écrira même peu de temps avant sa mort une lettre au bureau politique du parti suggérant de démettre Staline de ses fonctions de secrétaire général du parti. Sa violence l’inquiète. Mais ceci restera sans lendemain.

L’idée, pour résoudre la lutte des classes décrite par Marx est d’abolir la propriété des moyens de production et de remplacer celle-ci par une collectivisation. Cependant, dans un premier temps, la terre a bien été remise aux moujiks. Alors, on a entendu à ce sujet les pires âneries. Il était entendu que chacun pouvait être propriétaire de sa montre ou de ses chaussures. Non, c’étaient les moyens de production dont on visait la collectivisation. Du coup, plus de patrons, plus de lutte des classes, donc : dictature du prolétariat. Nous y reviendrons.

Cela n’a pas été aussi simple que ça.
Surtout dans les campagnes et il faut se souvenir que la Russie soviétique était très largement rurale.
A la mort de Lénine, Staline veut réaliser ces notions de façon rapide et, surtout, autoritaire. De plus, au lieu d’aller vers les mots d’ordres du passé (la terre à ceux qui la travaillent, les usines aux ouvriers et tous les pouvoirs aux soviets), Staline, les bolcheviks étant largement majoritaires dans de nombreux soviets, remplace les pouvoirs aux soviets par les pouvoirs au parti. Comme il se trouve qu’entre temps, le parti n’a plus de direction collégiale et que le congrès est réuni de plus en plus rarement, Cela veut dire que le parti c’est lui. En même temps, considérant que les opposants s’opposent à la dictature du prolétariat, il les interdit.

Nous arrivons donc, au lieu d’un foisonnement d’idées, à une situation inverse de ce qui était souhaité. Pas d’opposition possible, ni dans les soviets, ni dans la nation. Il ne ressort donc plus aucune possibilité de solutions autres.
Staline a scié la branche sur laquelle il était assis.
Une autre confusion se surajoute à la précédente. L’idée de « les usines aux ouvriers » (ce qui était une
vision proche de ce que prônaient les anarchistes), par un glissement en plusieurs étapes va perdre son sens. Cela se passe ainsi : les ouvriers, c’est les soviets ; les soviets, c’est
le parti et le parti, c’est l’état. Donc, les moyens de production ne sont pas remis aux travailleurs, mais à un état qui est lointain et qui confisque tous les revenus par des plans démentiels
et irréalistes.

Les ouvriers, au lieu de se sentir responsables de leur production s’en trouvent spoliés comme
au temps anciens. Malgré les tentatives du stakhanovisme, qui prétendait récompenser les bons travailleurs, la motivation s’écroule. Staline ne se pose jamais la question de savoir pourquoi la
production est mauvaise (tant en quantité qu’en qualité). Il considère que ces errances sont liées à de la mauvaise volonté. De là émerge la notion de sabotages ou de « social traître »
qu’il faut éradiquer. Bien sûr, les premiers visés sont les responsables de tous les niveaux et Staline élimine physiquement ses plus fidèles partisans

On raconte que certains, croyant que le « camarade Staline » n’était pas au courant de ce qui se passait, face au peloton d’exécution, sont tombés en criant « Vive Staline ».
Puisque tous les secteurs de l’économie et de la vie en URSS sont étatisés, on peut considérer que tous les citoyens de l’Union soviétique sont devenus comme une sorte de fonctionnaires.
Et là, j’en arrive à vous rappeler le principe de Peter.
Le Professeur Laurence J. Peter (1919 1990) et son collaborateur Raymond Hull (1919 1985), tous deux citoyens canadiens, énoncent (d’abord sous forme d’une plaisanterie puis sérieusement) les constatations suivantes :
En principe et dans l’idéal, un salarié incompétent ne reçoit pas de promotion et stagne dans son poste (où il est incompétent).
Toujours dans le même cadre idéal, un salarié compétent est promu à une fonction supérieure.

Dans cette nouvelle fonction, il peut être encore compétent et espérer une autre promotion. S’il ne l’est pas, on se retrouve dans le cas du salarié non compétent. En effet, un maçon peut être un excellent professionnel, un virtuose de la truelle et de la taloche, mais un très médiocre chef d’équipe.
De plus, dans le poste qu’il a quitté, on va promouvoir un autre salarié qui lui même est potentiellement incompétent.
Il s’en suit deux choses qui sont la même vue dans deux sens différents.
1°) Tout salarié au cours de sa carrière professionnelle peut gravir des degrés dans l’échelle sociale jusqu’à ce qu’il arrive à un niveau où il est incompétent. Niveau qu’il occupera jusqu’à la fin de sa carrière. C’est ce que Peter et Hull appellent le « niveau d’incompétence » ou le « poste terminal ».
2°) Réciproquement, tout poste, à terme, sera occupé par un salarié incompétent.
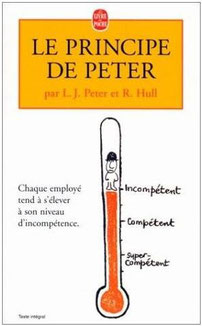
Un incompétent ne fait rien. Je me suis laissé raconter cette histoire d’un chef de service dans une direction départementale qui, d’emblée, à ses nouveaux adjoints expliquait : n’importe comment, il est entendu que nous ne prenons jamais de décision. Si une instance passe outre et que c’est une réussite, tant mieux ! C’est que nous avons eu raison et si ça ne fonctionne pas, nous pouvons toujours leur reprocher d’avoir pris une initiative qui ne leur incombait pas.
Pour masquer son incompétence, l’incompétent se cache derrière divers expédients (plus ou moins inconsciemment). Il applique scrupuleusement les règlements sans chercher à réfléchir (l’infirmière qui réveille son patient pour lui donner son somnifère). Il s’agite dans un pseudo activisme et ne se déplace qu’en courant avec deux ou trois dossiers sous le bras et une batterie de stylos différents dans la poche de sa chemise (bien visibles). De plus, assez rapidement, il somatise son mal de vivre en développant toutes sortes de maladies, donc des absences fréquentes, ou des comportements insupportables pour son entourage.
Il est clair que dans cette situation, l’incompétence stérilise l’éventuelle compétence qui se serait glissée là par hasard.

Cette situation est d’autant plus vraie que l’entreprise est plus vaste avec une hiérarchie plus complexe. En effet, il est entendu que le travailleur indépendant, seul dans son entreprise n’a pas de promotion à attendre. La micro entreprise de quelques salariés en est pratiquement exempte. Mais, la grande entreprise ou l’administration en fourmillent et, nous le disions déjà plus haut, on peut imaginer que tous les postes sont pourvus par un incompétent.
Peter en conclut que voilà une façon d’expliquer pourquoi les administrations et les pays fonctionnent si mal.
Comment remédier à cette situation ?
Deux solutions seraient envisageables.
1°) Il faudrait que le salarié refuse lui même sa promotion. Ceci est impossible parce que l’individu humain est avide d’ascension sociale tant pour des raisons financières que pour l’aura et la gloire de sa personne. Cela me rappelle un sketch d’un humoriste il y a quelques décennies. Le sujet en était les rêveries d’un appariteur assis devant une petite table dans un couloir obscure, tamponnant sempiternellement des convocations et qui se disait : « Ah ! si j’serais chef de service ! »

2°) Les promotions étant décidées par la hiérarchie, il faudrait que celle-ci dénonce ces promotions abusives. Ceci est également impossible sinon, la hiérarchie, en se désavouant elle même, reconnaîtrait sa propre incompétence dans la mission qui lui incombe et qui consiste à promouvoir ses collaborateurs ce qui n’est pas envisageable.
Au même titre, il va de soi qu’un hiérarque ne peut pas reconnaître sa propre incompétence. Quelle que soit la compétence ou l’incompétence de ses adjoints, il leur fait supporter le poids de ses propres incapacités par des brimades, des surcroîts de travail inutile et des sanctions parfaitement injustifiées. Si un subalterne est compétent, voir super compétent, pour faire, malgré tout tourner la machine, il va avoir tendance à prendre des initiatives ce qui est inadmissible par la hiérarchie incompétente ainsi mise en défaut.
Bon, je ne vais pas vous refaire ici toutes les conséquences du principe de Peter, mais je vous invite à vous documenter sur le sujet. Vous verrez, c’est passionnant et ce serait même drôle si ce n’était, dans le fond, aussi tragiquement sordide.
Mais, revenons-en à notre URSS.
Alors, hein, je vous la pose la question.
Qu’était-ce dans le fond que l’URSS si ce n’est une super administration tentaculaire, diversifiée, mais unique et monolithique ? A la fin de son existence, tous ses rouages étaient gangrenés d’incapacité et d’incompétence et, une organisation parallèle et interdite subvenait aux besoins réels.
Cela dit, vous croyez que cette description est la seule possible pour expliquer l’évolution de l’URSS ?
C’est là que vous vous trompez !
Il y a encore une bévue dans la compréhension du comportement humain et, et surtout, une appréhension du monde qui avait perdu son analyse dialectico-matérialiste.
Mais ça, c’est pour la prochaine fois !
Ici se termine la fin de la première partie de l'étude des partis en France.
Par manque de place, nous sommes obligés d'ouvrir une nouvelle page sur le site qui s'appelle: Les partis en France (fin). Dans le menu déroulant, c'est juste en dessous de cette page.
Comment Je Comprends les Choses
Pour Jean Durier-Le Roux, lors de son activité professionnelle, le plus grand moment de plaisir jubilatoire quotidien, c'était la cantine. Là, avec une demi-douzaine de galapiats de son espèce, il refaisait le monde. Et puis, la retraite est arrivée : plus de débats dialectiques passionnés. Alors, en toute humilité, il a décidé d'écrire ce qu'il aurait pu défendre véhémentement. Un nouveau problème s'est présenté. Jean Durier-Le Roux s'est souvenu du devoir de philosophie inhérent à la classe de terminale : « Peut-on penser par soi-même ». Il essaie. Ça, pour essayer, il essaie. Même, parfois, il a l'impression d'y arriver... Et là, son narcissisme s'en trouve revalorisé. De quoi se préoccupe-t-il ? A priori de n'importe quoi. Toutefois, il faut bien l'avouer, les sujets liés à la situation sociopolitique reviennent de façon récurrente. Est-ce à regretter ? Aristote, dans le premier chapitre de l'Éthique à Nicomaque, montre que le plus haut niveau de réflexion philosophique que l'on puisse avoir est celui qui concerne le politique. Alors, si c'est Aristote qui le dit...



